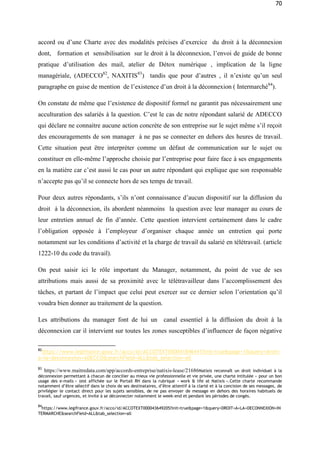LE DROIT A LA DECONNEXION DANS LE CADRE DU TELETRAVAIL EN FRANCE.pdf
- 1. Année scolaire 2020-2021 DIRECTEUR DES TRAVAUX : Mr HUGO GAILLARD Etudiante : Isciane DAUPHOUD MEMOIRE DE RECHERCHES DE FIN D‘ETUDES MASTER II ECONOMIE DU TRAVAIL ET MANAGEMENT DES RESSOURCES HUMAINES LE DROIT A LA DECONNEXION DANS LE CADRE DU TELETRAVAIL EN FRANCE
- 2. 1 Introduction …………………………………………………………………………… p 4-6 PREMIERE PARTIE : CONTEXTUALISATION………………………………… p7-21 CHAP I. Présentation du sujet et contexte actuel……………………………………… p 7-9 CHAP II. Présentation du cadre légal du « Télétravail » et du « Droit à la déconnexion ».................................................................................................................... p 9-21 DEUXIEME PARTIE : LA REVUE DE LITTERATURE ……………………… p 21-53 CHAP I .Le paysage du télétravail en France………………………………………… p 21-36 CHAP II. Le Droit à la déconnexion………………………………………………… p 37-42 CHAP III. L’exercice du droit à la déconnexion dans le cadre du télétravail « la Responsabilité des acteurs »…………………………………………………………….p 42-52 CHAP IV. Problématique- Hypothèse de recherche……………………………………p 53 TROISEME PARTIE : METHODOLOGIE……………………………………… p 54-55 QUATRIEME PARTIE : PRESENTATION DES RESULTATS……………….. p 56-62 CHAP I. Pratique du télétravail……………………………………………………… p 56 CHAPII. Degré d’autonomie/ satisfaction vie privée vie professionnelle………….. p 56-59 CHAP III. Management et contrôle………………………………………………… p 59-60 CHAP IV : Droit à la déconnexion…………………………………………………. p 61-62 CINQUIEME PARTIE : DISCUSSIONS DES RESULTATS…………………… p 63-72 CHAP I. Une Pratique de télétravail hostile à l’exercice du droit à la déconnexion----p 63-68 CHAP II. Des responsabilités mal assumées par l’entreprise dans l’effectivité du « droit à la déconnexion »…………………………………………………………………………. p 68-71 CHAP III. Un sujet peu maitrisé des salariés………………………………………….p 71-72 SIXIEME PARTIE : RECOMMANDATIONS…………………………………….p 72-74
- 4. 3 ABBREVIATIONS TIC Les technologies de l’information et de la communication DARES Direction de l’animation de la recherche des études et des statistiques INSEE Institut national de la statistique et des études économiques ANI Accord National Interprofessionnel CFDT Confédération Francaise démocratique du travail CGT Confédération générale du travail CAS Centre d’Analyse Stratégique
- 5. 4 INTRODUCTION La diffusion du télétravail dans les entreprises est une réalité indéniable, avec une estimation totale de plus de 3300 accords d’entreprises1 en référence au télétravail depuis le 17 mars 2020, date du début du confinement. Ce mode d’organisation qui fait ses beaux jours du fait de la crise COVID, s’imposera durablement aux dires des spécialistes du domaine du travail. Cette pérennité annoncée du Télétravail réside certainement dans une meilleure connaissance de ses implications pour les entreprises, notamment du point de vue du cadre légal mais aussi dans la révélation des opportunités qu’il renferme pour les salariés concernant l’amélioration de leur qualité de vie. Par ailleurs, les générations Y et Z2 , pour qui l’usage des TICS s’assimilerai presqu’a une banalité intégré dans un mode de vie routinier, représentent un vivier demandeur de télétravail, imposant ainsi aux entreprises d’en faire un outil d’attractivité et de fidélisation. On peut aussi noter, l’investissement des pouvoirs publics dans la diffusion et l’accompagnement des entreprises et des salariés dans la prise en main de cette forme de travail dont le cadre légal se clarifie de plus en plus pour ne laisser place à aucune réticence de ces derniers. Aujourd’hui, le télétravail qu’il soit occasionnel ou régulier, a domicile ou en tiers lieux est reconnu comme tel de sorte à le faire sortir de la clandestinité3 dans laquelle il évoluait antérieurement. Ainsi, tout semble présager de la durabilité du télétravail car tous les principaux freins à son développement qui ont prévalus il y’a 20 ans en arrière, au point de reléguer la France au rang des retardataires dans l’accueil de cette « révolution » semblent être levés. 1 17mars 2020 au 07juillet 2021, suivant base de données de Légifrance https://www.legifrance.gouv.fr 2 La génération Y, les milléniaux1 ou les millénariaux2 regroupent l'ensemble des personnes nées entre le début des années 1980 et la fin des années 1990. La génération Z est la génération née des personnes nées entre 19951 et 20104 . Elle succède à la génération Y, source Wikipédia 3 DARES 2004 ; Rapport B METLING 2015
- 6. 5 En effet, dans un classement des pays de l’OCDE4 réalisé par Le CAS5 en 2009, sur 5 groupes, la France occupait le quatrième groupe représentant les pays à la traine et dubitatif concernant la diffusion du télétravail, les pays du Nord de l’Europe et les États-Unis étant en tête avec plus de 20 % de télétravailleurs en activité. Les raisons identifiés relevaient entre autres des mentalités, précisément de l’attachement des Français à la conception Taylorienne du travail, de la méconnaissance par les entreprises des possibilités offertes par le télétravail mais aussi de la réticence du management de proximité reposant foncièrement sur le contrôle. (CAS 2009, Pierre Morel A l’Huissier 2006, Greenworking 2012). Si la numérisation de l’économie et le contexte actuel ont précipité la disparition de ces obstacles, force est de constater qu’il en existe de nouveaux. Aujourd’hui, le télétravail proposé est celui d’une consommation raisonnable, basé sur le volontariat et la réversibilité. Cette conception du télétravail révèle une réalité toute simple : préserver au mieux le salarié des effets pervers de cette forme d’organisation de travail. Ainsi face au télétravail, les risques avérés pour le salarié sont nombreux, et une grande partie de ceux-ci sont le fait de la connectivité permanente ou de l’hyper connectivité auxquelles sont exposés les télétravailleurs. En effet, le travail digitalisé accentue la porosité entre les sphères privé et professionnelle de sorte à menacer gravement la santé physique et psychologique du salarié. De ce fait, la création d’un « Droit à la déconnexion » se conçoit comme une solution légitime capable de lutter contre les inconvénients du télétravail et de permettre ainsi de profiter pleinement des bienfaits de cette forme de travail. La France envoie un signal fort en décidant d’être le premier pays au monde à consacrer légalement ce principe dans son code du travail en son article 2242-17. Le droit à la déconnexion se présente donc comme « le droit pour tout salarié de ne pas être connecté à un outil numérique professionnel en dehors de son temps de travail en vue d’assurer le respect de ses temps de repos, de congé et de sa vie personnelle et familiale6 ». 4 L'Organisation de coopération et de développement économiques est une organisation internationale d'études économiques, dont les pays membres des pays développés pour la plupart ont en commun un système de gouvernement démocratique et une économie de marché 5 Le Centre d'analyse stratégique était une institution française d'expertise et d'aide à la décision qui appartenait aux services du Premier ministre, créé en 2006, il fut remplacé en 2013 par France Stratégie 6 Définition basée sur celui du code du travail et de l’ANI de 2020 sur la bonne mise en œuvre du télétravail
- 7. 6 S’il existait déjà un droit au repos7 et un droit aux congés8 vieux de plus d’une centaine d’année, le droit á la déconnexion apparait comme le nouveau droit au repos des utilisateurs du digital dans le cadre du travail. Cela s’entend parfaitement lorsque l’on sait désormais que ces droits peinent à se réaliser effectivement du fait de l’introduction du travail dans des lieux qui leur étaient autrefois exclusifs. Par ailleurs, le législateur Français a décidé de confié la définition des conditions de mise en œuvre de ce droit au dialogue social et au chef d’entreprise mobilisant fortement la responsabilité des partenaires sociaux et des entreprises dans sa mise en œuvre effective. Ainsi, nous sommes loin d’un traitement homogène de ce principe qui voit ses modalités se décliner selon les entreprises et la vision qu’en font les partenaires sociaux. De même, on entend des voix s’élever pour contester le défaut de rigueur de ce principe, notamment dans l’exercice des attributions confiées à l’entreprise, ou encore, on assiste aux débats sur la nécessaire implication du salarié au travers de l’institution d’un devoir de déconnexion. Il convient dans un tel contexte de bien cerner les responsabilités résultant de l’exercice de ce droit et le cadre du télétravail s’impose comme le plus adapté à comprendre les enjeux qui y sont liés. Nous chercherons donc, au travers de notre étude, à comprendre la portée des responsabilités des acteurs dans la mise en œuvre effective de ce droit à la déconnexion dans le cadre du télétravail. Il est indéniable que les pouvoirs publics et les syndicats sont étroitement liés au sujet, cependant nous décidons de nous intéresser au noyau de l’entreprise et du salarié. Ainsi nous présenterons dans un premier temps la portée et l’intérêt de notre sujet dans le contexte de notre recherche, dans une deuxième partie, nous aborderons notre revue de littérature quand une troisième partie sera dédiée à la présentation de la méthodologie, laquelle sera suivie de la présentation des résultats, de la discussion des dits résultats et enfin des recommandations. 7 Promulgation 13 juillet 1906 - Article l3132 et suivants Tout salarié doit bénéficier d'un repos hebdomadaire. Le repos hebdomadaire est d'au moins 24 heures consécutives, qui s'ajoute à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives. 8 les premiers congés payés (jours de repos des salariés qui sont payés par l'employeur) sont apparus pendant l'été 1936, après la victoire électorale du Front populaire.
- 8. 7 PREMIERE PARTIE : CONTEXTUALISATION CHAP I : Présentation du sujet et contexte actuel En 1978, Dans son rapport au Président Valéry Giscard d’Esteing dénommé « Informatisation de la société », Mr SIMON NORA, en référence au développement de l’informatique, annonçait une révolution au même titre que la révolution industrielle qui viendrait changer la structure des organisations et créer un basculement des attitudes à l’égard du travail. Le Télétravail et le droit à la déconnexion, créations exclusives de la digitalisation du travail viennent confirmer cette « prédiction » de l’auteur. Ces deux notions, certes distinctes, entretiennent une relation étroite indéniable. En effet, si l’une est une forme d’organisation caractérisée par l’usage de l’outil numérique, l’autre se présente comme un moyen permettant de s’y soustraire. Ce lien étroit se révèle assez facilement au travers de la littérature scientifique, des études en la matière et des dispositions légales qui rendent compte des objectifs et des enjeux communs à ces 2 concepts. S’agissant du Télétravail, le contexte de Pandémie COVID l`a propulsé au-devant de la scène mondiale. En France comme dans la plupart des pays du monde, les pouvoirs publics s’en sont saisis autant comme levier de lutte anti Covid que comme moyen de préservation de la vie économique. En effet, l’article L1222 du code du travail prévoit expressément: « En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés ». Ainsi, pour soutenir ce « Télétravail subi »les pouvoirs publics ont déployés plusieurs actions en faveur de l’accompagnement des salariés et des entreprises dans la mise en œuvre de ce mode d’organisation considéré comme participant activement à la démarche de prévention du risque d’infection conformément au protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l'épidémie de Covid-19 .
- 9. 8 Des dispositifs comme « objectif covid » 9 ou encore des guides Téletravail10 sur site officiel ont été mis en place pour pallier le manque d’expérience de la plupart des entreprises et des salariés sur la prise en charge de cette forme de travail car rappelons le, selon une étude de la DARES publiée en 2019 le pourcentage de Télétravailleurs réguliers en France n’était que de 3% en 2017. Aujourd’hui, cette expérimentation grandeur nature du Télétravail a permis aux entreprises et aux salariés, dont les plus réticents, d’en découvrir les opportunités et les bienfaits. Ainsi, l’accord nationale interprofessionnelle de 202011 sur une mise en œuvre réussie du Télétravail indique dans son préambule, toujours dans le contexte Post Covid que « …de nombreux salariés souhaitent télétravailler plus régulièrement qu’auparavant et de nombreuses entreprises envisagent une mise en place élargie de cette organisation du travail …Les bénéfices attendus de son développement peuvent satisfaire autant les entreprises que les salariés, tout en tenant compte des problématiques inhérentes à sa mise en place ». En effet, plusieurs spécialistes du Management des ressources humaines (Théoriciens et praticiens), partage cette thèse de la pérennité du Télétravail post COVID. Pour certains, le Télétravail représente une opportunité d’innovation managériale offrant la possibilité aux entreprises de renoncer à leur structure hiérarchique rigide ; Pour d’autres, elle est un moyen de gestion des imprévus, notamment en permettant aux entreprises de poursuivre leurs activités en cas de crise, pour d’autres encore, elle est une aspiration des nouveaux télétravailleurs qui se sentent plus autonomes et ont pris conscience de l’intérêt de travailler ailleurs qu’au bureau. (SOUFYANE, PERRETI, QDM 2020, N°28 ; QDM 2020/4 N°30)12 ; Par ailleurs, cette lumière faite sur le Télétravail en a révélé davantage les limites dont celles liés à une connexion permanente du travailleur, au brouillage des frontières entre vie privée et vie professionnelle et aux risques psycho sociaux auxquels il s’expose. En effet il est admis qu’une connexion permanente (désigné comme le fait d’être constamment disponible même en dehors des heures de travail) peut engendrer des problèmes de santé (Stress, burn out, dépression…). 9 Objectif télétravail est un dispositif gratuit, mis en place par l'Anact (Agence nationale pour l'amélioration de conditions de travail) en faveur des TPE-PME voulant organiser le télétravail de manière efficace et maintenir les liens entre les équipes,. 10 https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/teletravail-en-mode- covid-19-on-vous-guide 11 Légifrance.fr 12 https://www.cairn.info/revue-questions-de-management-2020-2-page-159.htm https://www.cairn.info/revue-questions-de-management-2020-4-page-107.htm
- 10. 9 Aussi, le Législateur Européen s’est saisi de cette question. Dans sa résolution du 21 janvier13 2021, le Parlement européen mandate la Commission européenne afin qu’elle propose un cadre légal nouveau en faveur du droit à la déconnexion. Il recommande de ce fait que le droit à la déconnexion soit reconnu comme un droit fondamental et explicitement réglementé dans le droit de l’Union. A ce titre, les travailleurs pourront se déconnecter sans risquer des répercussions négatives. Le législateur insiste sur l’intérêt de cette question cela d’autant que « le travail à distance et le télétravail qui s’est accru pendant la pandémie devrait rester à un niveau plus élevé après la crise voire augmenter ». Il s’agit là d’une véritable avancée pour le droit à la déconnexion qui devient un droit internationale, ayant vocation à être reconnu et respecté par tous les pays de l’Union européenne. Car contrairement au télétravail, la question du droit à la déconnexion recèle peu d’études, et même si la France est le premier pays à s’être déclaré en faveur d’un « droit de déconnexion », son cadre légal témoigne d’un certain désistement du législateur au profit des acteurs de la vie d’entreprise (partenaires sociaux, entreprise, salarié), à qui il est confié la charge de sa mise en œuvre effective. Ainsi, tout l’intérêt de la question réside dans cette relative liberté laissée à ces acteurs dans l’exécution de leurs rôles concernant l’exercice de ce droit à la déconnexion. CHAP II : la présentation du cadre légal du « télétravail » et du « droit à la déconnexion » §1. Le cadre légal du télétravail en France a- Début du télétravail en France : Une formalisation tardive Le concept du Télétravail voit le jour aux USA en 1950, dans le cadre des travaux de Norbert Wiener sur la cybernétique14 . A ce titre, il fait référence à un architecte vivant en Europe qui supervise la construction d’un immeuble aux U.S.A. sans avoir à se déplacer, grâce à des moyens de transmission de données. En 1962, les premières expériences connues de télétravail sont en Angleterre où certaines firmes internationales ont commencé à délocaliser à 13 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0021_FR.html 14 vie public.fr- Alexandre Largier, 2001 https://www.cairn.info/revue-reseaux1-2001-2-page-201.htm
- 11. 10 domicile le travail de leurs programmeurs. Au début des années 1970, le principal fournisseur de services téléphonique américain, American Telegraph Telephon, prévoit que la plupart des américains travailleront à domicile en 199015 .Cependant, Le terme a proprement parlé nait de la notion « Telecommuting16 » introduite aux USA en 1973. La fin des années 70 se concrétise par l’intérêt manifeste des pouvoirs publics Français de saisir les enjeux et les opportunités liés au développement de l’informatique d’où le rapport en 1978 de Messieurs SIMON NORA et ALAIN MINC sur « l’informatisation de la société ». C’est à cette occasion que le terme « Télétravail » est lancé en France (CAS, 2009). Même si les années 80 furent marquées par quelques initiatives17 en faveur du Télétravail , la décennie 1990- 2000 voit une réelle volonté des pouvoirs publics de diffuser le télétravail. On assiste donc à l’éclosion de plusieurs actions concrètes en faveur du Télétravail. Au début des années 1990, le Télétravail est proposé comme une solution possible aux problèmes d’aménagement du territoire18 . Les années 1990,1992 et 1993 sont témoins du lancement de plusieurs appels a projet aux entreprises consistant en la diffusion du travail alterné domicile-entreprise et au déploiement en province des activités des administrations et du secteur privé, le tout piloté par la Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale (DATAR). De plus, L’année 1993 voit l’apparition du premier rapport officielle et exclusivement dédié au Télétravail, celui de Monsieur Thierry BRETON, "Le télétravail en France, situation actuelle, perspectives de développement et aspects juridiques". Une première définition juridique du Télétravail est proposée à cet effet. Le télétravail est donc: « Une modalité d’organisation ou d’exécution d’un travail exercé à titre habituel, par une personne physique, dans les conditions suivantes : d’une part, ce travail s’effectue à distance, c’est-à-dire hors des abords immédiats de l’endroit où le résultat de ce travail est attendu ; en dehors de toute possibilité 15 CAS 2009- Alexandre Largier 2001 https://www.cairn.info/revue-reseaux1-2001-2-page-201.htm 16 Naissance du terme « telecommuting » par Jack Nilles, consultant dans le domaine du télétravail à l’Université de Caroline du Sud (U.S.A.). En anglais britannique : « telework ».- Premier choc pétrolier mondial et premières applications concrètes de télétravail : la crise pousse les entreprises à résoudre les problèmes de perte d’énergie et à s’orienter vers des solutions leur permettant d’accroître leur productivité et la flexibilité de leurs salariés. (CAS 2009 ; viepublic.fr) 17 Rapport du Centre d’Analyse Stratégique 2009 18 Monique Haicault 1998, Rapport CAS 2009
- 12. 11 physique pour le donneur d’ordre de surveiller l’exécution de la prestation par le télétravailleur ; d’autre part, ce travail s’effectue au moyen de l’outil informatique et/ou des outils de télécommunication, y compris au moyen de systèmes informatiques de communication à distance : des données utiles à la réalisation du travail demandé et/ou du travail réalisé ou en cours de réalisation." Par la suite, quelques actions se poursuivent en 1995 au travers de séminaires et de colloques sur le Télétravail, sans recevoir l’adhésion des parties prenantes au concept car les entreprises y percevaient un risque de perte de leur pouvoir tandis que les organisations syndicales, craignaient des effets négatifs du point de vue de la charge de travail et du risque de destruction du lien social. (Fernandez, Guillot, Marrauld, Lavoisier 2014, Haicault, 1998). b- L’essor du cadre légal du télétravail Ce n’est finalement qu’au début des années 2000 qu’un cadre légal se dessine pour le Télétravail. La décennie 2000-2010 fut marquée par deux évènements majeurs dont l’accord cadre européen de 2002 et en France l’accord national interprofessionnel de 2005. L’accord cadre européen du 16 juillet 2002 est le premier du genre issu d'une négociation volontaire entre les partenaires sociaux européen. Il est le résultat de la volonté des partenaires sociaux de s’engager en faveur du développement du Télétravail qu’ils entendent : « à la fois comme un moyen pour les entreprises et les organisations de services publics de moderniser l’organisation du travail, et comme un moyen pour les travailleurs de concilier vie professionnelle et vie sociale et de leur donner une plus grande autonomie dans l’accomplissement de leurs tâches » Pour ces derniers « Si l’Europe désire tirer le meilleur parti de la société de l’information, elle doit encourager cette nouvelle forme d’organisation du travail, de façon à ce que la flexibilité et la sécurité aillent de pair, que la qualité des emplois soit accrue et que les chances des personnes handicapées sur le marché du travail soient améliorées19 ». Cet accord définit le télétravail comme «une forme d'organisation et/ou de réalisation du travail, utilisant les technologies de l'information, dans le cadre d'un contrat ou d'une relation 19 Tirée du préambule de l’accord-cadre 2002
- 13. 12 d'emploi, dans laquelle un travail, qui aurait également pu être réalisé dans les locaux de l'employeur, est effectué hors de ces locaux de façon régulière ». Cette définition large du télétravail est un choix des partenaires sociaux afin qu’elle puisse « s’adapter aux situations et pratiques diverses, sujettes à des évolutions rapides ». Par ailleurs, elle exclut de son champ d’application les travailleurs occasionnels et concerne exclusivement les travailleurs salariés. Elle intègre cependant les travailleurs nomades, en l’occurrence les cadres qui travaillent 1 ou 2 jours par semaine chez eux20 . Cet accord énonce deux principes majeurs dont : - le caractère volontaire du Télétravail qui résulte de la liberté du travailleur d’accepter ou non l’offre de télétravail faite par l’employeur si le télétravail ne fait pas partie du descriptif initial du poste. De même, Si un travailleur exprime le désir d'opter pour le télétravail, l'employeur peut accepter ou refuser cette demande. Cependant la possibilité est offerte au travailleur de s’engager ultérieurement en télétravail si cela n’a pas été prévu dans le descriptif initial du poste . - et la réversibilité du Télétravail, la décision de passer au télétravail est réversible par accord individuel et/ou collectif seulement si le télétravail ne fait pas partie du descriptif initial du poste, La réversibilité peut impliquer un retour au travail dans les locaux de l'employeur à la demande du travailleur ou à celle de l'employeur et les modalités de cette réversibilité sont établies par accord individuel et/ou collectif. Un autre principe posé par cet accord est celui de l’égalité des droits entre télétravailleurs et travailleurs exerçant dans les locaux. Conformément à cet accord cadre qui prévoyait sa transposition dans le délai de 3 ans à compter de sa signature en droit interne, un Accord national interprofessionnelle du 19 juillet 2005 relatif au télétravail voit le jour en France. L’Accord National interprofessionnel du 19 juillet 2005, retranscrit les dispositions de l’accord cadre en apportant certaines précisions importantes. En plus de reprendre la définition de l’accord cadre, l’ANI désigne expressément les télétravailleurs nomades et alternants (entreprises et hors entreprises) dans son champ d’application. Et ses précisions concernent : 20 Version commentée, Commentaires de YVES LAFARGUES
- 14. 13 - la définition préalable d’un délai de prévenance, qui se déclenche lorsqu’il est mis fin au télétravail durant la période d’adaptation imposée en cas d’accord pour passer au Télétravail et à l’échéance de laquelle le salarié peut retrouver un poste correspondant à sa qualification dans les locaux de l’entreprise. (article 2) - l’obligation pour l’employeur de fixer les plages horaires durant lesquelles le travailleur devra être contacté dans le cadre du respect de la vie privée (article 6) - une priorité d’embauche pour le retour du télétravailleur dans les locaux de l’entreprise : il s’agit là de l’expression du caractère réversible du télétravail prévu au profit du travailleur dont le télétravail ne fait pas partie des conditions d’embauche. Cependant contrairement à l’accord cadre de 2002, l’ANI offre au travailleur dont le télétravail fait partie des conditions d’embauche une priorité d’embauche a tout emploi vacant s’exerçant dans les locaux et correspondant à sa qualification. (art 3). La 3e décennie 2010-2020 marque un tournant important pour le télétravail qui fait son entrée dans le code du travail et subit plusieurs changements tant dans sa définition que dans son approche avant de s’imposer comme mode de travail exclusif avec l’avènement du COVID. C'est avec la loi relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives dite "Loi Warsmann21 " du 22 mars 2012 que la notion est introduite dans le code du travail à l'article L1222-9. Selon cette loi : "le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci". Cette définition se veut plus complète que celle de L’ANI de 2005, sans y ajouter d´éléments nouveaux. Elle intègre simplement le principe du volontariat et celui de contractualisation (contrat de travail, avenant au contrat) déjà admis par l’accord. 21 l’Assemblée nationale a adopté le texte définitif de la proposition loi relative “à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives” dite loi Warsmann dont le volet télétravail de l’article 46 du texte qui fait entrer le télétravail dans le code du travail. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000025553658
- 15. 14 On relève par ailleurs que cette loi n’a rien retranché aux dispositions de L’ANI de 2005 sauf à ajouter ou à préciser certaines d’entre elles. S’agissant de ses apports nouveaux, on peut souligner, - une instrumentalisation plus importante du contrat de travail, en effet la loi précise que le contrat de travail doit définir les conditions de passage en télétravail ainsi que les conditions de retour à un mode de travail traditionnel. il doit également fixer les modalités de contrôle du temps de travail, sauf si ces modalités sont déjà prévues par un accord collectif. - un renforcement du principe du volontariat, au terme duquel le refus d'accepter un poste de télétravailleur ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail. On note aussi, un renforcement des obligations de l’employeur. A ce titre, l’employeur doit : - prendre en charge tous les coûts découlant directement de l'exercice du télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci22 . - informer le salarié de toute restriction à l'usage d'équipements ou outils informatiques ou de services de communication électronique et des sanctions en cas de non-respect de telles restrictions23 , - donner au salarié priorité pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail qui correspond à ses qualifications et compétences professionnelles et de porter à sa connaissance la disponibilité de tout poste de cette nature24 , - organiser chaque année un entretien qui porte notamment sur les conditions d'activité du salarié et sa charge de travail - Enfin, la dernière innovation, sans doute la plus importante, porte sur la possibilité de recourir au télétravail en cas de circonstances exceptionnelles telles qu'une menace 22 Identification plus précise des charges incombant à l’employeur 23 Apport nouveau par rapport a l’ANI de 2005, suppose que l’employeur doit prévoir des sanctions pour non-respect des restrictions liées á l’usage de l’équipement 24 Nouvel apport de la loi WARSMANN ; celui de porter l’information au travailleur de tout poste disponible
- 16. 15 d'épidémie, ou en cas de force majeure, et ce, à titre d'aménagement du poste de travail pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés. 5 ans après, une ordonnance du 22 septembre 201725 , relative à la prévisibilité et à sécurisation des relations de travail vient redéfinir le télétravail et ses modalités de mise en œuvre. Il s’agit d’un autre tournant important car cette ordonnance vient élargir le champ d’application du télétravail pour intégrer les travailleurs occasionnels. Ainsi, l’article 21 de cette ordonnance vient modifier l’article 1222-9 du code du travail portant définition du Télétravail qui indique désormais que : « le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication que «… ». La loi WARSMANN de 2012 n’admettait que le télétravail régulier. Cette ordonnance, Par la suppression de l’expression « de façon régulière », vient mettre fin à la distinction entre télétravail régulier et télétravail occasionnel. Les autres apports concernent les points suivants: - La suppression de l'obligation d'un avenant au contrat de travail en cas de passage au télétravail. L’existence d’un accord collectif sur le télétravail suffit désormais á sa mise en place, ou à défaut, une charte rédigée par l'employeur. En l’absence d’accord ou de charte, le télétravail peut être formalisé par tous moyens. - La présomption d’accident de travail26 au profit de de tout accident survenu pendant les horaires de télétravail. - La reconnaissance d’un "droit au télétravail". L'employeur doit motiver tout refus de télétravail demandé par un salarié. 25 L'ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations du travail
- 17. 16 Enfin, L'accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020 pour une mise en œuvre réussie du télétravail est Le dernier texte de loi en référence au Télétravail en France. Il fut suscité par la généralisation du télétravail du fait de la Crise du COVID 2019. Cet accord a été signé par trois organisations patronales (U2P, CPME et Medef) et quatre syndicats de salariés (CFE-CGC, CFTC, FO, CFDT, refus de la CGT). Il est devenu obligatoire pour toutes les entreprises et les salariés appartenant à un secteur professionnel représenté par les 3 organisations patronales ci-dessus depuis un arrêté d’extension publié au Journal officiel le 13 avril 2021. La particularité de cet ANI est qu’il ne postule aucune révision du cadre légal du télétravail. Il se présente comme un instrument de facilitation dans la mise en œuvre du Télétravail notamment en regroupant les dispositions en la matière et en se faisant plus précis sur certains points. Cet objectif est d’ailleurs affirmé dans son préambule qui expose ceci : « Constatant que l’articulation entre ces sources juridiques n’est pas toujours aisément comprise par les employeurs et les salariés, les organisations signataires souhaitent, par le présent accord, expliciter l’environnement juridique applicable au télétravail et proposer aux acteurs sociaux dans l’entreprise, et dans les branches professionnelles, un outil d’aide au dialogue social, et un appui à la négociation, leur permettant de favoriser une mise en œuvre réussie du télétravail ». Il représente aussi, une retranscription partielle27 de l’accord cadre Européen du 22 juin 202028 sur la numérisation. Ainsi, en regroupant l’ensemble des dispositions applicables au télétravail dans son texte, cet ANI traduit ses objectifs autour de 8 points essentiels suivants : - Le télétravail dans l’entreprise (télétravail dans le fonctionnement de l'entreprise, cohésion sociale interne, attractivité) : en substance il est rappelé aux entreprises l’importance de porter un intérêt particulier à l’articulation entre présentiel et 27 ANI 2020 paragraphe 1 « Dans leur accord-cadre du 22 juin 2020, les partenaires sociaux européens soulignent d’ailleurs l’impact de la numérisation de l’économie sur l’organisation du travail, et notamment sur le télétravail. Il est rappelé que cet accord européen a vocation à faire l’objet d’une transposition dans chacun des Etat membres dans les trois ans suivant sa signature. Les acteurs sociaux au niveau national interprofessionnel s’inscrivent dans cette perspective. Ils soulignent que le présent accord permet de transposer les points 2, 3 et 4 du thème 21 de l’accord-cadre précité. » 28 La CFDT représentait les travailleurs français dans la délégation européenne..Ce texte promeut les négociations entre syndicats et employeurs dans chaque pays de l'UE sur les enjeux des transformations numériques telles que les modalités de connexion et de déconnexion, l’intelligence artificielle et la gouvernance des données qui l’alimentent, l’évolution des compétences et des emplois, l’utilisation des outils numériques et la charge de travail. L’accord met l’accent sur l’évolution des emplois et sur la nécessité de la mise à jour des compétences de travailleurs au moyen d’un fort investissement dans la formation professionnelle.
- 18. 17 distanciel et d’intégrer cette question dans le cadre du dialogue social. Par ailleurs les entreprises sont interpellées sur l’utilité d’anticiper les scénarios exceptionnels afin de se projeter sur des situations possibles concernant leur organisation. - la mise en place du télétravail (rappel des fondements juridiques, thème de dialogue avec les salariés et/ou leurs représentants, conditions d'accès) : il s’agit ici de déterminer les activités éligibles au télétravail dans le cadre d’un dialogue social professionnel, de rappeler le principe du double volontariat qui prévaut en cas de télétravail en temps de normalité et la nécessité d’un écrit même si le télétravail peut être formalisé par tous moyens. - Organisation du télétravail (maintien du lien de subordination, contrôle du temps de travail, droit à la déconnexion, frais professionnels et outils numériques, accident de travail) : il est rappelé dans ce cadre que le lien de subordination demeure avec le télétravail , que le salarié au forfait jours est astreint à la durée légal du travail et au temps de repos et que le droit à la déconnexion doit être pris en compte dans le cadre du télétravail. Les partenaires sociaux proposent d’évaluer les risques liés à l’éloignement du salarié et à la régulation des outils numérique ainsi qu’une liste de bonnes pratiques de l’usage de l’outil numérique29 . Ils sensibilisent les entreprises à la formation des collègues des télétravailleurs à cette forme de travail et au recours à une communication au sein de la communauté de travail afin de maintenir le lien social. Un autre point important est la référence au fait que l’employeur ne peut avoir une complète maitrise du lieu où s’exerce le télétravail et que le salarié est tenu de respecter et d’appliquer la politique de l’entreprise en matière d’utilisation des écrans et en matière d’ergonomie. - l'accompagnement des collaborateurs et des manageurs (formation, situations particulières, égalité entre les femmes et les hommes) ; il est fait mention dans cette partie du partage des responsabilités entre employeur et salarié cadre dans la mise en œuvre des nouvelles pratiques managériales issues du télétravail et de la confiance en 29 possibilité d’établir un socle de consignes minimales à respecter en télétravail, et communiquer ce document à l’ensemble des salariés ; - mise à disposition éventuelle des salariés une liste d’outils de communication et de travail collaboratif appropriés au travail à distance, qui garantissent la confidentialité des échanges et des données partagées ; possibilité de mise en place de protocoles garantissant la confidentialité et l’authentification du serveur destinataire.
- 19. 18 tant que critère essentiel à faire valoir dans la relation entre manager et employé. Par ailleurs, une liste des thématiques pouvant faire l’objet de formation est proposée et la formation des managers débutants au management à distance est recommandée. Concernant l’accessibilité des nouveaux salariés au télétravail, il est recommandé de respecter un certain délai. Le télétravail doit par ailleurs être mobilisé au profit d’aidants familiaux. - la préservation de la relation de travail avec le salarié (lien social, prévenir l'isolement) : il est proposé au entreprises de mettre en place des dispositifs ad hoc et de prévoir des règles de fonctionnement communes pour faire face au risque d’isolement du télétravailleur. - la continuité du dialogue social de proximité (droit syndical, représentation du personnel) ; il est rappelé que les règles collectives de travail légales et conventionnelles en cas de recours au télétravail restent applicables. On note l’affirmation de l’égalité des droits collectifs entre télétravailleurs et non télétravailleurs, ainsi que le maintien en vigueur des règles relatives aux négociations périodiques obligatoires pour les acteurs du dialogue social en télétravail. - la mise en œuvre en cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure. « les partenaires sociaux soulignent l’importance de prévoir dans l’accord ou, à défaut, la charte relatifs au télétravail, lorsqu’ils existent, les conditions et modalités de mobilisation du télétravail en cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure. A cet égard, il est préconisé le repérage en amont du périmètre des activités télétravaillables afin de faciliter la mise en place rapide du télétravail; « Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux et de CSE, les signataires encouragent les employeurs à organiser des concertations avec les salariés avant de mettre en place le plan de continuité par décision unilatérale ». - Mise en place d’un comité de suivi paritaire : Par cet accord, les partenaires sociaux créent un comité de suivi paritaire composé de représentants des organisations de salariés et d’employeurs qui devra se réunir au terme d’un délai de 2 ans à compter de l’entrée en vigueur de l’accord afin d’établir un état des lieux de l’évolution des
- 20. 19 pratiques, d’analyser l’impact du télétravail sur les entreprises et leur performance économique et sociale et d’évaluer la mise en œuvre des dispositions de l’accord. §2 Le cadre légal du droit à la déconnexion « Le Droit à la déconnexion » fait son entrée dans le code du travail avec loi dite « Loi travail30 » du 8 août 2016 en son article 55 qui prévoit son entrée en vigueur le 1er janvier 2017. Le principe est consacré par l’article L. 2242-17 point 7 du code du travail. A cet effet, c’est dans le cadre de la négociation collective annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail que ce principe sera mis en œuvre. Ainsi, aux termes de cette disposition, la négociation collective annuelle obligatoire doit porter sur : « Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques ». On relève que le législateur Français ne donne pas de définition claire du Droit à la déconnexion mais en fait une traduction du point de vue des responsabilités qui en résultent pour l’entreprise et de l’objectif qui lui est assigné à savoir le respect des temps de repos et de congés ainsi que de la vie personnelle et familiale. L’ANI de 2020 sur la mise en œuvre réussie du télétravail vient clarifier cette situation en disposant ceci « C’est le droit pour tout salarié de ne pas être connecté à un outil numérique professionnel en dehors de son temps de travail ». Plus récemment, les Etats de l’union Européenne ont décidé de de se doter d’un droit à la déconnexion harmonisé. Ainsi dans sa résolution du 21 janvier 2021, le parlement européen mandate la commission européenne à l’effet de proposer un cadre légal au droit à la 30 LOI no 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (1)
- 21. 20 déconnexion. Au travers de cette résolution, le parlement élève le droit à la déconnexion au rang de droit fondamental, lequel doit permettre aux travailleurs de se déconnecter sans risquer des répercussions négatives. Cette résolution définit le droit a la déconnexion comme « la prérogative légale que les travailleurs ont de s’abstenir de s’engager dans des tâches professionnelles (appels, courriels...) en dehors de leurs heures de travail, et pendant leurs vacances ou congés » Il nous parait important de noter l’ancienneté de l’idée ou de la notion du droit à la déconnexion même si le principe n’est consacré légalement que depuis 2017. En effet, La jurisprudence Française avait déjà donné le ton dans plusieurs affaires dans lesquelles elle avait tranché en faveur de ce principe. Dans une décision du 02 octobre 200131 , la Cour de cassation affirmait que le domicile devait être sanctuarisé car il était le lieu idoine dans lequel la vie professionnelle laissait nécessairement place à la vie privée. Elle a confirmé sa position dans un autre arrêt de 200432 au terme duquel elle décide que « le fait de n’avoir pu être joint en dehors de ses horaires de travail sur son téléphone portable personnel est dépourvu de caractère fautif et ne permet donc pas de justifier un licenciement disciplinaire pour faute grave ». Par ailleurs plusieurs textes en faisaient déjà référence avant la loi travail de 2016. Ainsi, l’accord national interprofessionnel sur la qualité de vie au travail du 19 juin 2013 proposait en son article 17 sur la promotion d’une gestion intelligente l’institution de « temps de déconnexion » comme moyen de concilier vie privée vie professionnelle dans le cadre de l’usage des TICS. De même un avenant du 1er avril 2014 a l’accord de branche SYNTEC33 , en son article 4-8-1 intitulé « temps de repos et obligation de déconnexion » prévoyait, en plus d’une obligation de déconnexion opposée au salarié, plusieurs obligations de l’employeur en faveur d’un droit à la déconnexion dont l’affichage dans l’entreprise des durées minimales de repos, la mise en place d’un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos et la possibilité pour le 31 Cass soc, 02 octobre 2001 pourvoi n° 99-42.727 32 Cass.soc., 17 février 2004, pourvoi n° 01-45.889 33 Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. - Textes Attachés - Avenant du 1er avril 2014 à l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail Etendu par arrêté du 26 juin 2014 JORF 4 juillet 2014 https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALISCTA000029264467/?idConteneur=KALICONT000005635173
- 22. 21 salarié au forfait annuel en jours d’avertir son responsable lorsqu’il est dans l’impossibilité de respecter la durée minimale de repos. DEUXIEME PARTIE : LA REVUE DE LITTERATTURE CHAP I : Le paysage du télétravail en France §1 Un paysage hétérogène a- des formes variées L’ANI du 26 novembre 2020 pour une mise en œuvre réussie du télétravail, contrairement à l’ANI du 19 Juillet 200534 et à l’article 1222-935 du code du travail se fait plus précis concernant les formes de télétravail. Au titre de cet accord, « Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux, de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication. Dans la pratique, il peut s’exercer au lieu d’habitation du salarié ou dans un tiers-lieu, comme par exemple un espace de co-working, différent des locaux de l’entreprise, de façon régulière, occasionnelle, ou en cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure. En tout état de cause, la mise en œuvre du télétravail doit être compatible avec les objectifs de performance économique et sociale de l’entreprise ». La définition ci-dessus désigne expressément, le Télétravail occasionnel, le télétravail régulier, le télétravail à domicile et en tiers lieux. Les salariés nomades, eux aussi, intègrent le champ d’application du télétravail avec L’ANI du 19 juillet 2005 qui précise néanmoins que le fait de travailler à l’extérieur des locaux de l’entreprise ne suffit pas à conférer à un salarié la qualité de télétravailleur. Ce texte identifie le télétravail alternant lorsqu’il précise que « Le caractère régulier exigé par la définition n’implique pas que le travail doit être réalisé en totalité hors de l’entreprise, 34 L’ani de 2005 vise exclusivement le télétravail régulier et ne désigne expressément que le télétravail nomade 35 cet article portant définition légale du télétravail ne fait référence á aucune forme de télétravail
- 23. 22 et n’exclut donc pas les formes alternant travail dans l’entreprise et travail hors de l’entreprise. De même la DARES (2004, 2018) dans ses différentes études sur le télétravail fait clairement la distinction entre télétravail fixe à domicile, télétravail alternant à domicile et télétravail nomade. Ces différentes distinctions ont été reprises par Bruno Metling dans son rapport de 201536 , lequel s’appuie sur les travaux du CAS37 de 2009 et sur l’accord télétravail France Télécom- Orange de 2013. Ainsi, on peut retenir globalement : - Le télétravail à domicile, avec alternance du travail dans les locaux de son employeur, et différents rythmes d’alternance selon la situation. Une variante est le télétravail occasionnel, qui répond à des situations inhabituelles ou des situations d’urgence (grèves des transports, etc...) - Le « télé-local », c’est-à-dire dans un centre proche de son domicile et partagé avec d’autres travailleurs, pouvant parfois relever d’employeurs différents. On pourrait à ce titre citer le télétravail en bureau satellite ou les télé-centres internes, qui relèvent d’un seul et même employeur ; mais encore les télé-centres péri-urbains multi-entreprises38 ; les sites de co- working39 , qui se développent, mais qui concernent souvent des travailleurs indépendants ; - travail nomade ou mobile, pour certains métiers prévoyant de nombreux déplacements (commerciaux en visite chez des clients, etc.) ; Selon la 36 Rapport Bruno Metling, sept 2015 a l’attention du Ministre du travail Myriam El KHOMRY - mission consistant à examiner la question de l'effet de la transformation numérique sur le travail. 37 Rapport du Centre d’analyse stratégique « Le développement du télétravail dans la société numérique de demain », 2009 fait référence aux conclusions du forum du droit de l’internet de 2004 qui distingue 4 formes de télétravail (en réseau au sein de l'entreprise dans des locaux distincts ; dans des locaux partagés par plusieurs entreprises ; .nomade ; à domicile) 38 Les télécentres urbains et périurbains, appelés également Smart Work Center au Pays-Bas ou en Belgique, sont des espaces de travail hybride, qui reprennent les services traditionnels des centres d’affaires (bureaux privatifs, salles de réunion, domiciliation), complétés par une offre plus flexible d’espaces de travail partagés utilisable à la journée, demi-journée, ou même à l’heure (LBMG Livre blanc tour de France 2012) 39 Wikipédia, Le coworking, ou cotravail, est une méthode d'organisation du travail qui regroupe un espace de travail partagé et un réseau de travailleurs pratiquant l'échange et l'ouverture ; juridiquement cela se traduit par une location d'espaces partagés de travail.
- 24. 23 DARES (2004)40 , le télétravailleur nomade est celui qui conserve un poste de travail physique dans l’entreprise mais utilise les TICS dans ses déplacements, à la maison ou chez ses clients pour se connecter au système d’information (SI) de l’entreprise. Le rapport LBMG tour de France (2012)41 ouvre une lucarne sur cette forme de travail, notamment sur la réalité de l’ouverture de plusieurs espaces dédiés aux travailleurs nomades. - Le « télémanagement42 », par lequel des salariés travaillent sur un site de l’entreprise, sans présence physique permanente d’un manager sur le site. Le « télémanager » doit alors gérer à distance une équipe localisée sur des sites différents. Le rapport B METLING relève les spécificités propres à chaque employeur concernant l’organisation du télétravail, notamment sur le nombre de jour travaillés à distance. Les travaux du LBMG43 tour de France du télétravail rapporte qu’en 2012, 48% des salariés télétravailleurs opéraient à distance entre 1 et 4 jours par semaine, le plus souvent un ou deux jours et 15% seulement était à temps plein. Selon des statistiques plus récentes44 (établies avant les grèves de 2019 et les deux confinements de 2020), en 2017, sur 3 % de télétravailleurs, 45% le pratiquent un jour par semaine, 26% deux jours par semaine et 29% trois jours par semaine. 40 DARES 2004 N°51.3 LE TÉLÉTRAVAIL EN FRANCE : 2 % de salariés le pratiquent à domicile-5 % de façon nomade 41 LBMG Worklabs, Le télétravail en France, 2012 -. Il cite comme exemple le Business lounge ouvert par les centres d’affaires Regus dans la station-service Shell de Limours-Janvry au sud-ouest de Paris, la création d’espaces entièrement dédiés à ces travailleurs par les hôtels comme la chaine d’hôtels Mercure. Il s’agit d’une tendance répandue aux Etats-Unis oú ces espaces ont été baptisés « coffice », contraction de coffee et office résumant bien l’atmosphère café-bureau de ceux-ci 42 Intégré dans l’accord sur télétravail France Télécom-Orange 2013 43 Laboratoire du travail de demain; entreprise spécialisée dans la conception de solutions originales intelligentes et collaboratives- a l’initiative du Livre blanc national sur le Télétravail et les nouveaux espaces de travail- tour de France du télétravail 2012 44 DARES Analyses N 051, novembre 2019, quels sont les salariés concernés par le télétravail ?
- 25. 24 b- Une distribution inégale dans le recours au télétravail - Selon la catégorie socioprofessionnelle « une pratique des cadres ». Le rapport de la DARES de novembre 201945 mettait en évidence le fait que le profil de certains postes de travail empêchait la mise en œuvre du télétravail malgré la reconnaissance d'un droit au télétravail par l'ordonnance de 201746 . Cette étude, plus récente que d’autres allant dans le même sens, montre que ce sont surtout les cadres qui peuvent télé-travailler. Selon l’enquête, 60,6 % des télétravailleurs sont cadres en 2017 alors que cette catégorie socioprofessionnelle ne représente que 16,9 % des salariés. Le constat est que 11,1 % des cadres et 3,2 % des professions intermédiaires pratiquent le télétravail au moins un jour par semaine alors que sa pratique est marginale chez les employés (1,4 %) et quasi inexistante chez les ouvriers (0,2 %). Selon l’étude ces très forts écarts reflètent notamment des disparités d’usage des outils numériques. Le Centre d’analyse Stratégique, dans son rapport de 2009 vient confirmer cette tendance. Il indique à cet effet que le profil type du télétravailleur français est celui d’un homme cadre ou ingénieur, malgré le fait qu’il pouvait être pratiqué par de multiples fonctions, y compris celles de nombreux agents de maîtrise (assistantes, par exemple). Selon le rapport la moitié des télétravailleurs à domicile sont ingénieurs ou cadres, et un tiers sont des professions intermédiaires. Ce sont donc 10 % des cadres télétravailleurs à domicile (4 % à temps plein, 6 % à temps partiel) contre seulement 2 % des professions intermédiaires qui sont concernés par cette pratique en 2017. L’enquête constate par ailleurs que le télétravail est relativement fréquent pour les cadres commerciaux et technico-commerciaux et pour les ingénieurs de l’informatique. Il est, au contraire, rare dans certains métiers comme, par exemple, ceux de l’hôtellerie, restauration, alimentation ou des services aux particuliers et aux collectivités. Un autre fait révélé est celui du lien de causalité directe entre la sur représentation des cadres dans le champ des utilisateurs mobiles et le travail à distance. La DARES47 , dans une enquête de 2018 confirme qu’un cadre sur deux dispose d’au moins deux équipements mobiles, ce qui 45 Dares ananlyses n° 051 novembre 2019 - collecte des enquêtes antérieure aux ordonnances sur le travail de septembre 2017, cette étude se concentre sur la pratique régulière du télétravail. 46 Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail dite Ordonnance MACRON 47 Étude de la DARES 2018 « quels liens entre utilisations des TIC et conditions de travail »
- 26. 25 facilite le travail mobile ou à distance. Ce constat avait été conforté par l’enquête Conditions de travail de 2005, qui indiquait que l’usage d’un ordinateur à domicile à des fins professionnelles concernait 37 % des cadres et des professions intellectuelles. Outre l’usage des TICS, le recours plus important des cadres au télétravail réside dans le degré d’autonomie jugée plus élevé parmi ces derniers et la relative simplicité de l’organisation du Télétravail pour les salariés au forfait jour48 . (CAS 2009 et DARES 2018). - selon le sexe –l’âge et le secteur d’activité Relativement au sexe et á l’Age, Le rapport du CAS de 2009, en reprenant les statistiques de l’enquête permanente des conditions de vie de l’INSEE sur la période de 1999 à 2003, rend compte de la réalité statistique suivant laquelle les télétravailleurs sont des hommes à 57 %, alors que les femmes sont proportionnellement plus nombreuses que les hommes à utiliser un ordinateur à titre professionnel sur leur lieu de travail. L’on observe un changement de tendance avec l’étude de la DARES49 de 2019, en référence á l’enquête SUMER50 de 2017. En effet le constat est que les femmes et les hommes recourent au télétravail régulier dans des proportions équivalentes, notamment chez les cadres (11 %). Ainsi, la proportion des femmes sur l’ensemble des 3% des télétravailleurs est établit à 2,9% contre 3,2 % pour les hommes soit un écart relativement faible. Cette enquête place même les femmes au premier rang des télétravailleurs intensifs, ceux télé-travaillant 3 jours ou plus par semaine. Ainsi en 2017, les femmes représentent 49,4 % de ces télétravailleurs, loin devant les professions intermédiaires qui représentaient 25%. 48 Le dispositif du forfait jours concerne les seuls salariés dotés d’un niveau d’autonomie nécessaire à l’exercice de leurs responsabilités cadres ou non cadres, qui ne peuvent donc prédéterminer leur temps de travail et/ou ne sont pas amenés à suivre l’horaire collectif applicable dans l’entreprise (L. 3121-43). Leur temps de travail se décompte alors en nombre de jours travaillés, et non plus en heures 49 Enquête excluant le télétravail occasionnel 50 La collecte de Sumer (Surveillance médicale des expositions des salariés aux risques professionnels est un outil de cartographie des expositions aux risques professionnels des salariés en France) étant antérieure aux ordonnances sur le travail de septembre 2017, il s’agit donc d’une estimation du télétravail formalisé cas régulier En effet, avant septembre 2017, la pratique occasionnelle du télétravail était a priori non formalisée et correspondait à du télétravail « gris ».
- 27. 26 Cette situation pourrait être corrélée avec une autre réalité établit par cette enquête, celle d’un recours plus important au télétravail des familles monoparentales ou dans les couples ayant un ou des enfants de moins de 3 ans. L’augmentation du Télétravail chez les femmes correspondrait alors à une volonté de concilier vie professionnelle et charges familiales. L’enquête ci-dessus établit par ailleurs une plus forte propension des salariés âgés de 30 à 49 ans au télétravail. En effet, en 2017, le Télétravail est plus répandu chez ces derniers que parmi leurs aînés (50 ans ou plus) ou que chez les salariés de moins de 30 ans parmi lesquels la proportion de cadres est plus faible. Même parmi les cadres, les salariés les plus jeunes sont ceux qui pratiquent le moins le télétravail. Les 30- 39 ans et les 40- 49 ans représentaient respectivement 3,2% et 3,9% de l’ensemble des télétravailleurs contre 2% pour les 15- 29 ans et 2,9% pour les 50-59 ans. Cette tendance avait été antérieurement retenue par la DARES en 2004 dans son rapport sur le télétravail en France, précisément sur le moindre recours des jeunes au télétravail fixe á domicile en raison de la moindre proportion de cadres parmi eux. Les séniors eux étaient moins représentatifs au niveau des télétravailleurs nomades. Toutefois il faut noter que ces enquêtes ne rendent compte que de la situation avant les ordonnances de 2017. L’enquête de la DARES 2004 ne concernait que le Télétravail à domicile et le télétravail nomade et celle de 2019, le télétravail régulier, excluant de ce fait le télétravail occasionnel. Concernant le secteur d’activité et la taille de l’entreprise, Les enquêtes TICS 2007 et 2008 de l’INSEE (Institut National de statistiques et des études économiques) avaient démontrés que le Télétravail était le plus développé dans les services liés aux TIC ou 55 % des entreprises le pratiquaient et 49 % dans les services financiers. Les services aux entreprises et les prestations intellectuelles comme le conseil et la publicité étaient aussi fortement impactés. Un autre constat de ces enquêtes était la prédominance de cette forme de travail dans les grandes entreprises, 65 % des entreprises d’au moins 250 salariés, contre 15 % des entreprises de 10 à 19 salariés pratiquaient le télétravail. Cependant ces enquêtes notent une diffusion du télétravail dans toutes les catégories d’entreprises notamment celles qui disposent d’ordinateurs et dont les salariés ont la possibilité d’accéder au système informatique de l’entreprise.
- 28. 27 L’enquête SUMER 2017 vient confirmer la première place du secteur de l’information et de la communication dans la pratique du télétravail. Elle indique à cet effet que ces secteurs très utilisateurs des nouvelles technologies connaissent une diffusion importante du télétravail. Près de la moitié des établissements concernés y ont mis en place le télétravail et, dans ces établissements, plus d’un salarié sur quatre y recourt effectivement en 2017. Selon l’enquête, la part de l’ensemble de télétravailleurs enregistré est de13, 5 % contre 5,9% pour les activités financières et d’assurance et 4,5% pour les activités scientifiques et techniques, lesquelles sont les représentations les plus importantes dans le secteur des services. Toutefois l’enquête fait état de la corrélation suivant laquelle, plus la part de cadres parmi les salariés est grande, plus celle des télétravailleurs augmente. Et ce quel que soit le secteur d’activité. §2 Consensus autour des effets du télétravail a- Rupture avec le modèle classique du travail salarié « rapport au temps, à l’espace et au lien de subordination» La littérature scientifique et les études nous permettent d’envisager le télétravail sous un angle plus intrusif, notamment du point de vue des changements profonds qui lui sont inhérents et qui transforment le travail (dans sa conception traditionnelle) dans ses rapports avec l’espace, le temps et le lien de subordination. - Temps et espace Dans son acception contemporaine, télétravail est envisagé comme un travail réalisé « à distance » de son entreprise, de sa hiérarchie et de ses collègues, soit hors de la classique unité de temps et de lieu (Fernandez, Guillot, Lavoisier, 2014). Ainsi, dans son ouvrage dénommé travail à distance et/ou travail à domicile : le Télétravail, les formes d’emplois, nouveaux contenus de travail des logiques contradictoires (1998), Monique HAICAULT écrit ceci : « Le Télétravail et le travail á distance s’inscrivent dans le mouvement de transformation sociale et économique qui affecte le système d’emploi et les organisations du travail, ils
- 29. 28 prennent forme dans de nouvelles conceptions du mode de vie, liées à des formes d’emploi et á des situations de travail marquées par la diversité flexible de leur localisation, la souplesse temporelle de leur exécution, ils accompagnent aussi la modification des temps et des espaces sociaux ainsi que les rapports de ces acteurs á ces catégories de la pratique » Cette représentation du télétravail fait consensus au sein de la littérature scientifique. En effet, le Télétravail est considérée comme un facteur de déstructuration du temps social et du rapport à l’espace (Morel-a-L’Huissier, 2006). Taskin (2010) l’identifie comme une forme de travail « déspacialisé » du fait de la rupture qu’il introduit dans l’unité de temps, de lieu et d’action qui caractérise l’organisation traditionnelle du travail. Dumas et Ruiller (2014) aborde dans le même sens en faisant référence à une dispersion spatiale et temporelle. Monique HAICAULT (1998) intervient précisément sur la manière dont il déstructure le temps et l’espace. Elle rapporte de ce fait que « Le télétravail tend á déconstruire cet arbitraire social temporel, celui qui rythme et accompagne dans nos sociétés le déroulement de la journée, de la semaine, les activités sur NTIC dans des espaces aux identités brouillées, place les individus dans un temps hétérogène qui n’est plus codifié par des rituels, des bornes temporalisés collectives et régulières. Le piège d’un temps non borné est tendu par l’espace lui-même non segmenté, sans limites matérielles ». Ainsi, la levée des bornes tant temporelles que matérielles introduite avec le télétravail vient renouveler la conception traditionnelle de la durée effective du travail qui ne peut plus être identifiée par le temps durant lequel le salarié est à disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. De plus comme TASKIN (2003), l’illustrait si bien, être « au bureau », signifiait qu’on travaillait ou qu’on faisait ses heures mais avec le Télétravail la non-présence n’est plus associée à l’absence, ou à l’absence de travail. - La relation d’emploi « entre autonomie et contrôle » En France, le lien de subordination est un élément fondamental de la relation d’emploi. Le contrôle éventuel est alors lié au lien de subordination que crée le contrat de travail (Caroline Diard et Nicholas Dufourt 2021).
- 30. 29 Même si le lien de subordination demeure avec le télétravail ( rappelé par l’ANI de 2020 sur une mise en œuvre réussie du télétravail), la notion de subordination et surtout ses modalités se trouvent profondément modifiées notamment par une refonte des modalités de contrôle du temps de travail (CAS 2009 ). Dans son rapport « Le télétravail en France, situation actuelle, perspectives de développement et aspects juridiques » remis en 1993 au Premier ministre, Thierry Breton définit le Télétravail comme le travail qui s’effectue à distance, c’est-à-dire hors des abords immédiats de l’endroit où le résultat de ce travail est attendu ; en dehors de toute possibilité physique pour le donneur d’ordre de surveiller l’exécution de la prestation par le télétravailleur ». Cette définition, contrairement à celle en vigueur actuellement, met en lumière la relation de contrôle, entre le travailleur et son donneur d’ordre, dans le cadre du Télétravail. Si Traditionnellement, le contrôle managérial consiste en une supervision directe et relève de la visibilité, précisément de la capacité pour le manager d’observer directement le travailleur, ses horaires, les processus de travail et la présence, permettant au manager d’interagir avec le travailleur (Taskin, 2010, Fernandez, Guillot & Marrauld 2014), le télétravail implique un relâchement du contrôle et de la supervision de l’exécution des tâches par le management (CAS 2009). DIARD ET DUFOURT 2021 désigne la distance géographique induite par le télétravail comme facteur d’autonomisation du salarié par rapport à l’encadrement, permettant à ce dernier de modifier l’ordre des tâches, la cadence, les méthodes, de prendre une pause, de fixer soi-même ses objectifs et de choisir ses partenaires de travail. Toutefois, des réserves sont à émettre. Pour TASKIN (2003), si le travail à distance accroit l’autonomie du télétravailleur, cela ne l’absout pas d’un contrôle a posteriori des tâches accomplies de la part de son supérieur hiérarchique. La liberté qui lui est octroyée se fonde sur l’organisation de son temps, de son travail et sur la maitrise du lieu où la mission est accomplie, mais elle ne porte pas sur le contenu de la tâche réalisée. Dans le même ordre d’idée, A. Karsenty, 1994 (in PONTIER 2014) indique que les procédures mises en place, l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, viennent réduire l’autonomie en permettant aux membres de l’équipe, a l’encadrement ou aux clients, de contrôler a tout moment le salarié.
- 31. 30 DIARD, DUFOURT (2021) se réfèrent aux règles juridiques ou organisationnelles de l’entreprise pour limiter cette autonomie au travail du télétravailleur. b- Des effets contrastés « entre bénéfices et risques » b-1 le rapport au travailleur « conciliation vie privée-vie professionnelle » - Sur les bénéfices Au regard de l’Accord Nationale Interprofessionnelle de 2005 sur le Télétravail et du rapport au président de la république relatif à l’ordonnance du 22 septembre 2017 sur la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, le Télétravail est présenté comme un moyen pour les salariés de concilier vie professionnelle et vie sociale et de leur donner une plus grande autonomie dans l’accomplissement de leurs tâches. L’article 20 de l’accord nationale interprofessionnel sur la qualité de vie de 2013 dispose que la conciliation des temps comprend les questions d’horaires de l’entreprise, les horaires et l’éloignement des lieux d’accueil des enfants, les rythmes scolaires, les moyens de transport, les capacités de logement, de restauration et les commerces. Au fil des études et des travaux, ce sont ces critères qui sont généralement retenus pour traduire « la conciliation entre vie privée et vie professionnelle » qui apparait comme un indice essentiel à l’appréciation du Télétravail en tant que bénéfice pour le salarié. Le CAS dans son rapport de 2009 relevait que : « L’un des enjeux majeurs du développement du télétravail aujourd’hui est de donner une plus grande flexibilité du travail au salarié en lui permettant de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle, par exemple, d’interrompre sa journée de travail pour aller chercher un enfant à l’école ou rendre visite à une personne âgée puis de reprendre son travail en soirée ». Cette perception des avantages du télétravail est la même pour TASKIN (2003) qui écrit que l’intérêt du Télétravail réside dans l’opportunité perçue de combiner des sphères auparavant séparées : un emploi intéressant, les tâches domestiques et le temps libre.
- 32. 31 Le télétravail serait aussi apprécié par les travailleurs du domicile qui voient l’opportunité de travailler dans un environnement familier, calme et autorisant une flexibilité supplémentaire en matière de temps de travail et de conciliation des rôles (Tremblay, 2002), tout en évitant des déplacements coûteux en temps et en argent ( Trembay et Le bot 2001 in Trembal 2002). Cette Analyse viendrait conforter l’enquête de la DARES (2019) qui retient que la situation familiale joue sur le recours au télétravail. La part de salariés appartenant à une famille monoparentale et celle des salariés en couple avec un enfant de moins de 3 ans pratiquent régulièrement le Télétravail. En 2017, 17,8% des salariés pratiquant le télétravail trois jours ou plus par semaine sont en couple et vivent avec au moins un enfant de moins de 3 ans alors qu’ils ne représentent que 14,1 % de l’ensemble des télétravailleurs réguliers. Par ailleurs, le temps gagné sur le trajet du fait du télétravail se révèle être un indicateur important dans l’appréciation d’une meilleure répartition entre vie privée et professionnel. En réduisant les trajets et la fatigue associée et en autorisant des horaires plus souples, le télétravail favorise l’articulation des temps professionnels et des temps privés (Metzger et Cléach, 2004 ; Guillaume et Pochic, 2009 , Obergo 201851 ). Un autre rapport52 établit que le Temps moyen gagné au profit de la vie familiale par jour de télétravail est de 37 mn. C’est ce temps épargné en déplacements et les horaires flexibles qui participent une meilleure articulation des temps privés et professionnels (Jean-Luc Metzger, 2009). Par ailleurs les personnes qui pratiquent le télétravail et celles qui les supervisent affirment que le télétravail diminue le stress et la fatigue. (Tremblay, 2001 in Tremblay 2002). L’enquête OBERGO53 (2018) permet de constater une amélioration de la qualité de vie des télétravailleurs. 51 L’enquête Obergo 2018 révèle que le recours au télétravail s’accroît avec la distance du domicile au lieu de travail. ainsi, Les salariés pratiquant le télétravail résident 1,5 fois plus loin de leur lieu de travail que leurs collègues qui ne le pratiquent pas. En 2017, 9,0 % des salariés résidant à plus de 50 km de leur lieu de travail télétravaillent contre seulement 1,8 % des salariés travaillant à moins de 5 km de leur domicile qui ne le pratiquent pas. 52 Le rapport Greenworking 2012 53 Observatoire du télétravail et de l’Ergostressie, Impacts du télétravail 2018, « de plus en plus de qualité et de productivité avec de moins en moins de Stress » https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/inline- files-two/2018-05-16%20OBERGO%20-%20Rapport%20enquete%20T%C3%A9l%C3%A9travail%202018.pdf
- 33. 32 - Sur les risques/ entre débordement sur la sphère privée et les risques pour la santé Si la plupart des études admettent les nombreux avantages du Télétravail, elles admettent tout autant les risques liées à cette pratique, précisément l’impact de l’utilisation des outils numériques dans l’organisation du travail. DUMAS et RUILLER (2014) alertent sur le brouillage des frontières entre les divers temps sociaux et un envahissement de la vie privée. Pour ces derniers, « si le télétravail peut réduire un conflit « vie professionnelle / vie familiale », il peut faire déborder le travail au-delà de la frontière que le salarié souhaite édifier entre son travail et sa vie hors du milieu ordinaire de travail ». Les auteurs relèvent aussi les risques psycho sociaux et la surcharge de travail qu’induit ce brouillage des frontières. De même, une enquête de la DARES 201854 établit une forte corrélation entre l’usage d’outils numériques permettant le travail mobile et une charge de travail et une charge mentale importante ainsi qu’à des situations fréquentes de débordement du travail sur la sphère privée. Ainsi les TICS peuvent inciter les individus à prolonger indéfiniment leurs activités professionnelles au détriment de leur temps personnel d’où les risques sur la santé physique et mentale des individus dont fatigue, stress, épuisement professionnel (GENIN 2009). Sont mis en cause cette hyper-connexion, et cette surenchère communicationnelle et informationnelle propre au travail mobile. (BOONEN 2017) Dans le même ordre d’idée, Le Rapport B METLING (2015) identifie le Télétravail comme un facteur de stress au travail en créant chez le salarié un sentiment de sollicitation permanente, d’accélération soutenue des interactions. Il serait aussi facteur de maladies professionnelles telles que le burn out encore le « FOMO » (Fear Of Missing), une forme d’anxiété sociale entraînant un rapport obsessionnel aux outils de communication professionnels 54 DARES ANALYSES N°029 JUIN 2018 « QUELSLIENS ENTRE LES USAGES DES OUTILS NUMERIQUES ET LESCONDITIONS DE TRAVAIL
- 34. 33 La résolution du 21 janvier 2021 du parlement Européen relative au « DROIT A LA DÉCONNEXION », retranscrit les conclusions d’EUROFOUND suivant lesquelles près de 30 % des télétravailleurs à domicile affirment travailler pendant leur temps libre tous les jours ou plusieurs fois par semaine, contre moins de 5 % des personnes travaillant dans des bureaux, et que ces derniers sont plus enclins à avoir des horaires irréguliers; Elle note par ailleurs que le travail régulier à domicile peut avoir un impact négatif sur la santé physique des travailleurs du fait que les lieux de travail créés ad hoc à domicile, ainsi que les ordinateurs portables et autres équipements TIC, peuvent ne pas répondre aux normes ergonomiques. Les maux de tête, la fatigue oculaire, l’anxiété et les troubles musculo- squelettiques; le stress lié au travail et les troubles du sommeil sont identifiés comme les risques du télétravail régulier. Par ailleurs, ces effets négatifs seraient plus ou moins intenses en fonction du type ou de la forme de télétravail pratiqué. Ainsi, l’enquête de la DARES 2004 ci-dessus référencée fait clairement une distinction entre télétravailleur alternant à domicile, télétravailleur fixe á domicile et télétravailleur nomade. Elle relève le fait que les premiers sont exposés à un large débordement de la vie professionnelle sur la vie privée contre un moindre impact dans le cas du dernier. De même, s’agissant du Télétravail en tiers lieux, les écrits mettent en évidence son faible rapport au débordement du travail sur la sphère privée. Ainsi, le Télétravail en télé-centre n’implique pas une confusion des temps privés et professionnels du fait de sa réalisation dans un temps et un lieu déterminé distinct de la vie privée du salarié et de sa soumission aux horaires et aux contrôles similaires a un bureau traditionnel (Taskin, 200655 - Pierre Morel a l’Huissier 2006). b2- Le rapport à l’entreprise - Sur les gains 55 Télétravail et régulations - Regards économiques No.37
- 35. 34 Au titre de ses bénéfices pour l’entreprise, les études se positionnent en faveur d’une hausse de productivité de l’entreprise, d’une réduction des coûts et d’un renforcement de l’attractivité. Selon une Etude de perception réalisée par Malakoff Médéric Humanis en partenariat avec l’IFOP du 30/11/2018 au 11/12/2018 auprès d’un échantillon représentatif de 1 604 salariés (dont 581 managers) et 401 dirigeants d’entreprises d’au moins 10 salariés, près de 9 télétravailleurs sur 10 estiment gagner en efficacité dans leur travail. Ce point de vue est partagé par 67% des managers qui encadrent les télétravailleurs ainsi que par les dirigeants ,79% d’entre eux estiment que le télétravail permet un engagement accru et une plus grande productivité des équipes. Le même constat est établi par une enquête antérieure (Greenworking 2012) à l’issue de laquelle 85% des entreprises interrogées considèrent que le télétravail améliore leur productivité, avec une hausse entre 5 et 30% de la productivité et une plus grande motivation des salariés. Ces enquêtes rendent aussi compte d’une réduction de l’absentéisme à hauteur de 20 % reconnu par près de la moitié des dirigeants parmi les bénéfices du télétravail et une réduction de la surface des locaux allant jusqu’à 30 % d’économie sur la surface immobilière (enquête Malakoff 2018, Greenworking 2012). Le télétravail est aussi considéré comme un vecteur d’attractivité et de fidélisation pour l’entreprise. L’Accord nationale Interprofessionnelle de 202056 est explicite à ce sujet. Elle indique de ce fait que le télétravail peut constituer un critère et un atout pour renforcer l’attractivité de l’entreprise confrontée à des difficultés récurrentes de recrutement, et un outil de fidélisation des salariés, notamment dans certains bassins d’emploi en répondant aux besoins des salariés et entreprises qui y trouvent de nombreux bénéfices. . - Sur les difficultés Le rapport du télétravail a l’entreprise a soulevé des implications nouvelles pour les entreprises qui sont amenées à repenser les modalités de mise en œuvre de leurs obligations et de leur gestion vis-à-vis des employés. Ainsi, certaines études font écho des risques pour 56 ANI Sur la mise en œuvre réussie du télétravail
- 36. 35 l’employeur en télétravail au titre desquels figurent en bonne position la Gestion des risques au niveau des Accidents de travail, la gestion du contrôle et de l’évaluation du travailleur. -Concernant les accidents de travail, l’article 1222-9 du code du travail pose le principe de la présomption d’imputabilité en matière d’accident de travail. Il dispose cet effet que « L'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens de l’article L. 411-1 Code de la Sécurité Sociale57 . L’accident est présumé d’origine professionnelle lorsqu’il surgit au temps et au lieu du travail. Or, ce sont justement ces notions qui sont bouleversées dans l’hypothèse du télétravail. L’ANI de 202058 reconnait explicitement les difficultés de mise en œuvre pratique d’une telle disposition. Le CAS (2009) dans son rapport explique ces difficultés qui proviendraient des abus potentiels des salariés résultant de fausses déclarations d’accidents de travail et de la difficulté d’en quantifier l’ampleur. Ce qui constituerait un risque pour l’employeur de voir le nombre de fraudes augmenter avec le passage en télétravail. Cette situation est aussi admise par le rapport B. Metling (2015) qui soulève plusieurs questionnements sur les moyens potentiels qui permettraient de faciliter l’appréciation de l’accident professionnelle en télétravail dont l’existence d’un espace de travail bien défini prévu au domicile du télétravailleur, la détermination précise des horaires de travail dans le contrat de travail , l’examen de la position du télétravailleur en connexion informatique ou non avec l’entreprise au moment de l’accident. Il reconnait par ailleurs que ce protocole aurait tendance à détourner le télétravail de son objectif principal. -La thèse d’une hausse du contrôle, Plusieurs travaux font état des difficultés pour le Management de mettre en œuvre ses prérogatives de contrôle en situation de télétravail. En 57 , est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne travaillant à quelque titre et en quelque lie que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs 58 Art ?Le télétravail étant une modalité d’exécution du contrat de travail, la présomption d’imputabilité relative aux accidents de travail s’applique également en cas de télétravail. Malgré les difficultés de mise en oeuvre pratique, c’est ce que prévoit explicitement le code du travail. ANI 2020 Incertitude sur la couverture des accidents du travail dans le cadre du télétravail à domicile
- 37. 36 effet la distance géographique permise par les TICS rend le contrôle temporel difficile, ce qui induit un contrôle renforcé des collaborateurs. C’est la situation que révèlent plusieurs études (Fairweather 1999, Wicks, 2002 in Taskin 2006). Ces études concluent à un lien potentiel entre télétravail et surveillance rapprochée par le biais des TICS. Ainsi, les nouvelles technologies peuvent s’apparenter à des technologies de contrôle du fait de la possibilité technique de surveiller à la fois l’activité et les déplacements des salariés. Cependant même si cette surveillance est légitimée par l’intérêt de l’organisation, elle doit rester proportionnée, justifiable et nécessaire. (TASKIN TREMBAY 2010 ; ANI 2020). Pour SCALLEREZ ET TREMBLAY (2016), l’augmentation du contrôle peut aussi trouver son explication dans la crainte pour le management intermédiaire de perdre son autorité et son contrôle sur le caractère effectif des horaires de travail, ce qui induirait une difficulté d’évaluation du salarié. De ce qui relève de l’évaluation du salarié rendue difficile en Télétravail, Bobiller (2003), explique que l’éloignement physique (du bureau) remet en cause la visibilité de l’apport du télétravailleur à l’activité de l’entreprise. Ainsi, pour ce dernier, le fait d’être présent dans l’entreprise donne le sentiment de contribuer effectivement au fonctionnement de l’entreprise. Dès lors, en prenant de la distance avec son entreprise, le salarié se soustrait au regard des autres ainsi qu’à une reconnaissance professionnelle qui est moteur de l’implication et de la motivation au travail. De même, selon Pontier (2004 : 103 in TASKIN ET TREMBLAY 2010), la non-prise en compte des comportements individuels et du potentiel de l’individu, s’avère difficile en raison du manque d’observation directe de la part du manager, et ce fait tient le salarié davantage éloigné des opportunités de progression professionnelle. TASKIN ET TREMBLAY (2010) indique, à leur tour la difficile gestion des carrières induite par une situation de travail à distance, en raison de l’éloignement physique du travailleur et des outils d’évaluation et de contrôle utilisés. Pour les auteurs, s’il est admis que le contrôle du résultat est le plus adapté au Télétravail, les gestionnaires apprécient à court terme les travailleurs sans se soucier de les développer dans la perspective d’une carrière à long terme».
- 38. 37 CHAP II : Le droit à la déconnexion §1 Le contenu du droit à la déconnexion b- Définitions et objectifs Le droit á la déconnexion est consacré par l'article L. 2242-17 du Code du travail en son point 7. Ainsi, la loi l’intègre dans le cadre de la négociation collective annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail qui doit porter sur : « Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques ». Le législateur Français définit le « droit á la déconnexion » du point de vue des objectifs qu’il lui assigne à savoir le respect des temps de repos et de congé , le respect de la vie personnelle et familiale. L’objectif du législateur est de permettre la conciliation entre vie privée et vie professionnelle et de préserver la santé physique et mentale des usagers des TICS dans l’exercice de leur activité professionnelle. Le législateur européen (dans sa résolution du 21 janvier 2021 contenant des recommandations à la commission sur le droit à la déconnexion) donne une approche plus précise des prérogatives du salarié dans l’exercice de son droit à la déconnexion. Il le présente à cet effet comme un droit fondamental qui permet aux travailleurs de s’abstenir de s’engager dans des tâches professionnelles telles que les appels téléphoniques, les courriels, et autres communications numériques en dehors des heures de travail, y compris pendant leurs vacances ou autres formes de congés.
- 39. 38 Loic le rouge (2017) dans son article intitulée « le droit à la déconnexion a la française »59 en présente une autre facette en expliquant que le sens du texte (article 2242-17, code du travail) est qu’un salarié ne puisse pas être sanctionné ou subir les reproches de son employeur quand il a refusé de répondre à un courrier électronique ou à un appel en dehors de ses heures de travail. Parallèlement, L’objectif de ce droit consistant en la préservation de la vie privé et de la santé est rendu légitime par la reconnaissance officielle et partagée de la littérature scientifique, des rapports et enquêtes officiels des risques encourus par les travailleurs du numérique. (CAS 2018, Rapport B Metling-2015, francis Jaurigueberry-2019, DARES 2018, Dumas- Ruiller 2014, Eurofound 2019) convergent sur la réalité de ces risques. Le législateur Européen en fait une liste relativement complète dans le texte ci-dessus référencé. Il identifie à ce titre le brouillage des frontières entre vie privée et vie professionnelle dû à une intensification de la charge de travail et l’allongement du temps de travail, la surcharge cognitive et émotionnelle, des tensions musculaires et des troubles musculo-squelettiques dû aux manipulations répétitives monotones et une posture statique pendant de longues périodes , la dépendance à la technologie, la privation de sommeil, l’épuisement émotionnel, l’anxiété et l’épuisement professionnel. c- discussions sur le cadre juridique - un droit attribué de façon discriminatoire et qui exclut le CHSCT, au titre des limites du droit á la déconnexion, les auteurs LOIC LE ROUGE (2016) ET LAETICIA MOREL (2017) mettent en évidence l’exclusion des entreprises de moins de 10 salariés dans le champ d’application du droit à la déconnexion. En effet, ils dénoncent le fait que les obligations de négocier, ne concernent que les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections 59
- 40. 39 syndicales60 d'organisations représentatives soit dans les entreprises de plus de 50 salariés, le Comité d’entreprise61 à partir de 20 salariés et les délégués du personnel dès 11 salariés62 Selon LOIC LEROUGE (2017), en vertu de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur et son obligation de mettre en œuvre les principes généraux de prévention, les entreprises de moins de 10 salariés doivent également appliquer des mesures liées au droit à la déconnexion. L’auteur s’interroge sur l’efficacité d’une charte alors même que la négociation n’a pas pu aboutir ou que la taille de l’entreprise ne le permet pas. Il propose de ce fait d’introduire les modalités d’exercice du droit à la déconnexion directement dans le règlement intérieur issu du pouvoir unilatéral et de direction de l’employeur qui pourra être soumis au contrôle de l’inspection du travail ou bien du juge du travail en cas de litige relatif à son application. Par ailleurs, pour Leticia Morel (2017), en habilitant les organisations syndicales à définir les modalités de plein exercice du droit à la déconnexion, le législateur crée le risque d’un manque d’homogénéité de ce droit et partant, d’une distribution inégalitaire de celui-ci laissant chaque entreprise édicté son droit à la déconnexion. Par ailleurs, les auteurs voient dans la non association expresse du CHSCT dans la mise en œuvre du dispositif, une limite du cadre du droit à la déconnexion car , le sujet du droit à la déconnexion concerne l’impact des conditions de travail sur la santé du travailleur et de ce fait relève des compétences de l’institution. -Un droit déconnecté de la charge de travail, LAETICIA MOREL (2016) dénonce l’exclusion de la charge de travail comme mesure dans la réalisation du droit à la déconnexion. Pour elle, c’est parce que la charge de travail risque d’être déraisonnable que l’usage de l’outil numérique peut l’être également. 60 La section syndicale regroupe l’ensemble des salariés appartenant à un même syndicat dans une entreprise. Elle peut être constituée dans toute entreprise sans condition d’effectif. L’organisation syndicale est représentative lorsqu’elle remplie certains critères dont celui du score obtenu aux dernières élections professionnelles. Si l’entreprise compte plus de 50 salariés, le syndicat représentatif désigne un délégué syndical, dans le cas contraire, le délégué du personnel peut être désigné délégué syndical. Ainsi, toutes les entreprises ne connaissent pas de sections syndicales 61 Le comité d’entreprise a des attributions économiques et sociales. Ses membres sont élus dans les entreprises d’au moins 50 salariés 62 Le délégué du personnel représente les salariés auprès de l’employeur et lui fait part des réclamations individuelles ou collectives en matière d’application de la réglementation du travail. La mise en place de délégués du personnel est obligatoire lorsquel'effectif de l'entreprise atteint au moins 11 salariés
- 41. 40 Elle insiste sur le fait que la loi Travail ne fait aucun lien direct entre charge de travail et droit à la déconnexion. Pour cette dernière, la question, sans prise en compte du souci lié à la charge de travail peut être perçu comme une occasion manquée de créer un nouvel outil de négociation obligatoire car une évaluation de cette question permettrait d’assurer l’effectivité du droit au repos. C’est cette position que soutient le rapport B Metling63 . Il recommande à ce titre de compléter la mesure du temps de travail par la mesure de la charge de travail pour les secteurs dans lesquels celle-ci est pertinente. Selon le rapport la durée du travail n’est plus un outil suffisant pour appréhender la contribution de tous les salariés car le constat de l’intensification de la charge de travail induite par la transformation numérique rend nécessaire d’intégrer par le dialogue social une mesure de la charge de travail plus adaptée que celle du temps de travail. -Un droit sans contraintes, sur la question, les propos recueillis par EMMANUEL GRIL auprès de Me Marianne Plamondon (Diagnostic -revue de gestion 2020) rendent compte d’une législation Française non contraignante en matière de droit á la déconnexion. L’avocate explique que « Les entreprises ont une obligation de moyens dans la mesure où elles doivent élaborer une politique interne en la matière et mettre en place des dispositifs destinés à réguler l’utilisation des outils numériques. Néanmoins, même si elles se dotent d’une charte définissant les modalités de l’exercice du droit à la déconnexion, elles ne sont soumises à aucune obligation de résultat. C’est un mécanisme non contraignant qui pose de grands principes afin que les salariés n’aient pas l’obligation de se connecter mais cela n’empêche en rien ceux qui veulent répondre à leurs courriels professionnels à minuit de le faire. » Pour elle, l’effectivité du Droit á la déconnexion requiert l’imposition de règles strictes et des obligations, notamment en indiquant quels salariés n’ont pas à se connecter en dehors de leurs heures de travail.. LOIC LEROUGE (2016) fait une analyse similaire tenant au fait que si l’employeur est tenu de négocier, il reste tout de même maître de la décision, car il n’est pas lié par l’avis des représentants du personnel. L’auteur déplore le défaut de sanction en cas d’absence de Charte. 63 B.METLING 2015 Préconisation 23
- 42. 41 La sanction du non-respect de l’obligation de négocier étant d’un an de prison et de 3 750 euros d’amende (article L. 2242-8 du Code du travail), §2- Des modalités pratiques du droit à la déconnexion Un état des lieux des modalités pratiques de la déconnexion fait état d’une diversité de dispositifs mis en place par les entreprises. Comme le relève Laeticia MOREL (2017), dans une entreprise, le droit à la déconnexion pourrait se concrétiser par soit par un droit pour le salarié de ne pas répondre au téléphone en dehors de ses heures de travail, soit de ne pas ouvrir sa boite mail le week-end, tout en devant se tenir prêt pour la réunion du lundi matin. Dans une autre entreprise, le droit à la déconnexion se matérialisera par une coupure des serveurs informatiques tout le long du week-end. En effet, un état des lieux des accords et dispositifs rendent compte de cette réalité. On peut faire référence à l’accord de branche Syntec 2014 et a l’accord d’entreprise société générale 2016 (Accord Télétravail Société Générale, 19 octobre 2016.) en faveur d’une obligation de déconnexion des salariés, ou encore à la décharge de l’obligation de répondre aux mails tardifs chez Michelin (2015), et a l’institution de journées sans mail chez ATOS (vendredi zéro email ATOS 2011) Au rang des entreprises, pionnières sur le sujet, le rapport B Metling cite le constructeur automobile Volkswagen qui a mis en place en 2011 un dispositif de mise en veille des serveurs entre 18h15 (heure de fin officielle de la journée) et 7 heures le lendemain matin. Il cite aussi la firme automobile Daimler-Benz qui a donné l’option à 100 000 de ses employés de participer au dispositif Mail on Holiday en août 2014. A ce titre les courriels envoyés aux salariés durant leurs périodes de congés sont suivis d’une réponse automatique redirigeant l’interlocuteur vers des contacts disponibles ou l’invitant à réexpédier son message au retour de l’intéressé. Plus récemment encore, la société Total, au travers d’un accord d’entreprise du 03 octobre 201964 , s’engage en faveur d’une mise en œuvre effective du droit à la déconnexion. Le 64 Cet accord concerne tous les salariés des 17 sociétés du groupe TOTAL pour une durée de quatre ans. Il a été conclu avec la CFDT, la CFE-CGC, l’UNSA et la CAT (autonomes).Dans la suite de l’accord d’entreprise « One Total, Better Together » qui a pour objectif « d’améliorer la qualité de vie au travail et de construire une entreprise où il fait bon vivre » l’accord de déconnexion a pour ambition inscrite dans le préambule de
- 43. 42 dispositif prévoit entre autres l’impossibilité pour le salarié d’être sanctionné ou pénalisé s’il n’est pas joignable pendant ses temps de repos, congés ou suspension du contrat de travail, il insiste sur le caractère raisonnable des objectifs fixés au salarié et sa charge de travail ainsi que de leur compatibilité avec la durée du travail. L’accord prévoit en outre des actions de sensibilisation dont la diffusion et la promotion d’un guide du droit à la déconnexion , une campagne de sensibilisation et la réalisation d’une enquête de perception afin de mesurer l’évolution des pratiques l’année suivant la signature de l’accord. Un mode opératoire différent de mise en œuvre du droit à la déconnexion nous est présenté par ANNICK SCHOTT (2019) dans le cadre d’une enquête réalisée auprès d’une PME Gironde, l’entreprise JED. En effet, le chef d’entreprise, dans une note d’information jointe au bulletin de salaire rappelle l’article L 2242-17, 7° du code du travail. Cette note indique que l’utilisation des outils de communication doit se faire dans le respect des personnes et de leur vie privée, dans un usage raisonnable et efficient. Elle souligne que rien ni personne ne doit se sentir obligé de répondre aux courriels. L’auteur souligne le caractère informel du choix du chef d’entreprise mais qui se révèle être efficace du fait de l’existence d’un collectif fort marqué par l’engagement mutuel et le relationnel dans les entreprises à taille humaine. CHAPITRE III : L’exercice du droit a la déconnexion dans le cadre du télétravail « la responsabilité des acteurs » §1- Enjeux du droit à la déconnexion dans le cadre du télétravail a-Un moyen de régulation du télétravail Van Laethem Nathalie. (2019)65 traduit de façon concise le lien entre Télétravail et droit à la déconnexion lorsqu’elle écrit ceci « La généralisation des outils numériques a très significativement modifié les modes de travail. Le bureau fixe a disparu dans certains métiers, les salariés sont « connectés » en dehors des heures de bureau, la frontière entre vie « prévenir l’hyper-connexion liée à la nature possiblement addictive des outils numériques et à préserver la santé des salariés ». 65 « Outil 43. Le droit à la déconnexion », dans : , La méga boîte à outils de l'agilité. sous la direction de Van Laethem Nathalie. Paris, Dunod, « BàO La Boîte à Outils », 2019, p. 136-137. URL : https://www.cairn.info/la-mega-boite-a-outils-de-l-agilite--9782100794058-page-136.htm
- 44. 43 professionnelle et personnelle est floue, le temps de travail n’est plus continu… C’est pour s’adapter à ces réalités et fixer un cadre à la protection de la santé des salariés qu’un droit à la déconnexion est inscrit dans la loi depuis le 1er janvier 2017. Les entreprises ont la responsabilité de définir les moyens concrets qui permettent l’application de ce droit. » Le droit à la déconnexion concerne tous les salariés amenés à utiliser les nouvelles technologies dans leurs activités professionnelles (travailleurs sédentaires, télétravailleurs, travailleurs dits « nomades ». Cependant il revêt une importance toute particulière pour les télétravailleurs au regard des risques liées à cette forme de travail, en l’occurrence le brouillage des frontières entre vie privée et vie professionnelle et les risques sur la santé. (cf chap I) L’article 17 de l’Accord National Interprofessionnel sur la qualité de vie au travail de 2013 visant à Promouvoir une gestion intelligente des technologies de l’information, présente le droit à la déconnexion comme un moyen de régulation de l’usage des TICS dans le cadre du travail , permettant la « conciliation entre vie privée et vie professionnelle ». En effet, Si le télétravail est présenté comme une forme d’organisation de travail permettant une meilleure conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle( article 1222-9 du code du travail), « le droit à la déconnexion » est conçu comme le canal, la condition de réalisation de cet objectif, précisément en permettant « le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale » du salarié ( article L. 2242-17 du Code du travail ). L’article 1222-9 du code du travail, sans référence expresse au droit à la déconnexion en précise une modalité de mise en œuvre dans le cadre du télétravail lorsqu’elle dispose que « … L'accord collectif applicable ou, à défaut, la charte élaborée par l'employeur dans le cadre du télétravail doit préciser : La détermination des plages horaires durant lesquelles l'employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail » Ainsi le droit à la déconnexion est envisagé comme une solution permettant de lutter contre les risques liés au télétravail. C’est dans le constat d’une Télé disponibilité généralisée, d’une dépendance, et d’une joignabilité permanente des télétravailleurs (Valérie Fernandez,
- 45. 44 Caroline Guillot, Laurie Marrauld, 2014)66 et des risques consécutifs sur la santé et l’équilibre vie privée et vie familiale que ce droit acquiert toute sa légitimité. b- Un enjeu particulier pour les cadres Le rapport B Metling (2015) reprenant les travaux de Francis JAURIGUEBERRY (DEVOTIC,2013), rappelle que 72 % des cadres travaillent dans des entreprises qui n'ont pris aucune mesure de régulation de la communication via les outils numériques et plus d'un tiers ont le sentiment de ne bénéficier d'aucun droit à la déconnexion, et que c’est ce constat qui a motivé son inscription au sein de l’accord national interprofessionnel du 19 juin 2013 relatif à l’amélioration de la qualité de vie au travail67 (article 17). Certains syndicats défendent avec virulence le droit à la déconnexion de leurs cadres. L’UGICT68 CGT déclare être la première organisation syndicale en France à avoir introduit le terme de droit à la déconnexion en 2014. En novembre 2015 le syndicat adresse à la ministre du Travail des propositions rédigées pour « réduire le temps de travail à l’heure du numérique ». Il revendique par ailleurs sa participation active à l’introduction du droit á la déconnexion dans la loi de 201769 . Ainsi, ses motivations se traduisent au travers de son baromètre UGICT-CGT/Viavoice 201670 qui révèle que la majorité de ses cadres et professions techniciennes vivent un débordement de la vie professionnelle sur leur vie privée, estiment que leur charge de travail a augmenté et souhaitent disposer d’un droit à la déconnexion afin de préserver leur vie privée 66 TÉLÉTRAVAIL ET « TRAVAIL À DISTANCE ÉQUIPÉ » Quelles compétences, tactiques et pratiques professionnelles ?Valérie Fernandez, Caroline Guillot, Laurie MarrauldLavoisier | « Revue française de gestion »2014/1 N° 238 | pages 101 à 118 . 67 Article 17 visant Promouvoir une gestion intelligente des technologies de l’information et de la communication au service de la compétitivité des entreprises, respectueuse de la vie privée des salariés 68 La CGT des ingénieurs, cadres, techniciens et agents de maitrîse 69 En mars 2016, 56 % des cadres et 59 % des professions intermédiaires UGIC CGT se disent favorables à la mise en place d’un droit à la déconnexion. Ajouté à la pression de la mobilisation contre la loi Travail, le gouvernement introduit le droit à la déconnexion dans la loi. 70
- 46. 45 et leur santé.71 Il propose par ailleurs de rendre effectif et possible le droit à la déconnexion en s’assurant que l’organisation et la charge de travail du salariée concernée le permet. La Cfdt cadres n’est pas en reste dans cette course au droit à la déconnexion, elle affirme son implication déjà en 1995 par la diffusion d’une brochure où figure la nécessité de négocier « le droit à l’isolement et le droit de coupure » qui deviendront selon elle le « droit à la déconnexion ». Elle relève sa contribution au rapport B Metling sur la base duquel, défend- elle, le devoir de déconnexion est inscrit dans la loi dite « travail »72 . La CFDT explique qu’en plus du travail qu’ils ont toujours rapporté à la maison, les cadres ont aussi à traiter celui qu’ils continuent de recevoir par mail ou messagerie instantanée tout en alimentant eux-mêmes le flux. Ainsi le trop plein de sollicitations parfois simultanées peuvent provoquer chez certains cadres une overdose qui peut aller du simple « ras-le-bol » au burn out. Elle propose donc de bien évaluer la charge de travail de chacun en amont de toute solution apportée à la déconnexion afin qu’elle soit adaptée à un temps de travail raisonnable et n’engendre pas des besoins réguliers de reconnexion au-delà. Elle insiste sur la nécessité de ne pas appliquer des solutions toutes faites mais bien partir de la réalité de l’entreprise GENIN (2014), reprend dans son article intitulée « Quels facteurs influencent la satisfaction des cadres à l'égard de l'équilibre des temps (personnel et professionnel) » les conclusions de son enquête ≪ Travail et Temps ≫ menée au printemps 2012, lesquelles confirment la position des syndicats concernant le rapport de leur cadre à la déconnexion. Cette enquête a été menée par voie électronique sur le site Internet de la CFDT Cadres et révèle que la charge de travail ressentie exerce l’influence la plus significative sur l’insatisfaction des cadres face à l’équilibre des temps. L’auteur met en évidence la complexité de la mesure de la durée du travail chez les cadres et plus encore pour les cadres au forfait jour. Concernant ces derniers, le rapport B Metling 71 75 % des cadres utilisent les TIC pour des raisons professionnelles sur leur temps de repos. 56 % des cadres souhaitent disposer d’un droit à la déconnexion effectif afin de préserver leur vie privée et leur santé, 46 % des professions techniciennes constatent un débordement de la vie professionnelle sur la vie privée, 59 % des professions techniciennes souhaitent disposer d’un droit à la déconnexion effectif afin de préserver leur vie privée et leur santé, 69 % des cadres considèrent que leur charge de travail a augmenté, 58 % des professions techniciennes considèrent que leur charge de travail a augmenté, 48 % des cadres travaillent plus de 45 heures hebdomadaire28 % des professions techniciennes travaillent plus de 45 heures hebdomadaire 72 https://www.cadrescfdt.fr/sites/default/files/plaquette-droit-et-devoir-de-deconnexion.pdf
- 47. 46 (2015) en admettant que le forfait jour est le mieux adapté au travailleurs du numérique, recommande de le sécuriser et de conjuguer la mesure de la charge de travail à celle du temps de travail. On entend bien cette corrélation triangulaire évidente entre télétravail, cadres et droit à la déconnexion. Les télétravailleurs sont majoritairement des cadres, ces derniers sont victimes du débordement du travail sur le temps personnel et des risques consécutifs sur la santé de sorte qu’ils ressentent le besoin indispensable d’exercer leur droit à la déconnexion. §2 Responsabilité des acteurs/ entre droit et devoir de déconnexion a- Au niveau de l’entreprise et du management - Au niveau de l’entreprise La définition des modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils dans ce sens se réalise dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la qualité de vie au travail et l’égalité professionnelle. (Art 2242-17 du code du travail) Ainsi, l’article 17 de l’accord national interprofessionnel du 19 juin 2013 sur la qualité de vie au travail ayant pour objet la promotion intelligente des TICS, donne quelques orientations applicables à la prise en charge par les entreprises du droit à la déconnexion dans le cadre du Télétravail. Elle dispose, après avoir rappelé les incidences des TICS sur la vie des salarié, que : « … Les signataires proposent aux entreprises de prendre en compte cette question, en identifiant les avantages et les inconvénients de ces évolutions. Les entreprises s’attacheront à mettre en place des formations à la conduite du changement et à l’utilisation des TIC pour les salariés ayant des difficultés particulières pour les maîtriser. Elles rechercheront, après avoir recueilli le point de vue des salariés sur l’usage des TIC dans l’entreprise, les moyens de concilier vie personnelle et vie professionnelle en tenant compte des exigences propres aux caractéristiques de l’entreprise et des fonctions exercées, par l’institution, par exemple, de temps de déconnexion, comme cela se pratique déjà dans
- 48. 47 certaines entreprises. Elles pourront mettre en place des actions de sensibilisation sur le bon usage des TIC auprès des salariés et du management. » De ce qui précède, il ressort pour les entreprises les responsabilités suivantes : - Identifier les avantages et les inconvénients des évolutions liés aux questions du télétravail et à l’usage des TIC du droit à la déconnexion - Mettre en place des formations au profit des salariés en difficulté sur ces pratiques - Prendre en compte l’avis des salariés sur l’usage des TIC et leurs besoins en matière de conciliation entre vie privée et vie professionnelle, notamment par l’institution de temps de déconnexion - Mettre en place des actions de sensibilisation sur le bon usage des TIC auprès des salariés et du management En sus de ces dispositions, cet ANI propose plusieurs autres orientations aux entreprises susceptibles de s’appliquer à la négociation sur le droit à déconnexion à savoir : établir un diagnostic préalable73 ; définir des indicateurs spécifiques à l’entreprise74 ; accompagner les équipes de direction et de management75 . Le rapport B Metling 2015, dans le même sens préconisait ceci : « Au sein de l’entreprise, différentes démarches, pas forcément juridiques mais tout aussi efficaces, doivent encourager la déconnexion : 73 Article 14 de l’ANI QVT 2013 « … Le diagnostic préalable doit permettre de déterminer les enjeux propres à l’entreprise en matière de qualité du travail et de conciliation des temps qualitatif et quantitatif, il doit être établi selon des modalités réalisables quelle que soit la taille de l’entreprise, en croisant notamment les éléments déjà existants dans l’entreprise.. » 74 Article 15 ANI QVT 2013 Trois grands types d’indicateurs peuvent être retenus : des indicateurs de perception des salariés (susceptibles d’être appréciés notamment au regard des conclusions des rapports Gollac/Bodier, Lachmann/Larose/Pénicaud et Nasse/Légeron) ;des indicateurs de fonctionnement ;des indicateurs de santé au travail. Permettant d’évaluer la mise en oeuvre d’actions concrètes dans l’entreprise, donc relevant des thèmes qui seront retenus par les négociateurs de l’entreprise dont la conciliation entre vie privée et vie professionnelle, les modalités de mise en œuvre de l’organisation du travail, l’environnement physique du travail. 75 article 16 ANI QVT 2013 Le rôle du management, comme celui de la direction, est primordial dans toute démarche visant à améliorer la qualité de vie au travail. Au quotidien, il organise l’activité, fait face aux difficultés rencontrées par les salariés et est un relais essentiel de la politique de l’entreprise. A cet effet, il est nécessaire que l’employeur précise le rôle du management et les moyens nécessairesmis en œuvre pour qu’il puisse exercer ce rôle. Une meilleure sensibilisation et une formation adéquate des managers en matière de gestion d’équipes et de comportements managériaux sont de nature à favoriser la qualité de vie au travail. L’objectif est d’aider ces managers à mieux appréhender les difficultés en prenant en compte les conditions réelles d’exercice du travail, à favoriser les échanges sur le travail, à savoir mieux identifierles conditions d’une bonne coopération dans leurs équipes.
- 49. 48 - Edition de chartes, configuration par défaut des outils, actions de sensibilisation, notamment par l’exemplarité des Managers. - permettre aux salariés de s’exprimer sur l’utilisation des outils numériques dans leur travail au sein des espaces de discussion. - Le développement de dispositifs de régulation interne des usages des outils numériques associant systématiquement les utilisateurs sur le contenu, la finalité et les règles d’utilisation de ces outils, ainsi que la mise en oeuvre des projets ». - sensibiliser et former à l’usage du numérique. La Résolution du Parlement européen du 21 janvier 2021 contenant des recommandations à la Commission sur le droit à la déconnexion76 se fait plus insistante sur la nécessité pour les employeurs de veiller à informer les travailleurs de leur droit à la déconnexion afin qu’il puisse l’exercer. Le parlement Européen estime que les employeurs doivent fournir aux travailleurs des informations suffisantes, y compris une déclaration écrite, énonçant leur droit à la déconnexion, dans laquelle devraient figurer, au minimum, les modalités pratiques de la déconnexion des outils numériques à des fins professionnelles, y compris tout outil de contrôle ou de surveillance lié au travail, la manière dont le temps de travail est enregistré, l’évaluation de la santé et de la sécurité par l’employeur et les mesures de protection des travailleurs contre tout traitement défavorable et de mise en œuvre du droit de recours des travailleurs. Elle prévoit par ailleurs qu’ il convient que les employeurs n’exigent pas des travailleurs qu’ils travaillent en dehors des heures de travail et que les employeurs ne favorisent pas une culture professionnelle du «toujours en ligne», dans laquelle les travailleurs qui renoncent à leur droit à la déconnexion sont clairement favorisés par rapport à ceux qui n’y renoncent pas. Par ailleurs, l’article L. 1222-10 du Code du travail impose à l’employeur d’organiser chaque année un entretien portant notamment sur les conditions d’activité et la charge de travail des salariés. En concertation avec le salarié télétravailleur, il doit aussi fixer, les plages horaires durant lesquelles il peut habituellement le contacter. 76 Il s’agit d’une résolution du Parlement Européen qui invite la Commission européenne à rédiger une Directive, qui devra être respectée par les États membres, garantissant aux travailleurs, en télétravail ou non, le droit à la déconnexion.
- 50. 49 Pour la CFDT cadres la question de l’évaluation de la charge de travail et de sa durée est incontournable pour rendre effectif le droit à la déconnexion car ce sont les premières causes de la « sur-connexion ». - Au niveau du management L’accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020 pour une mise en œuvre réussie du télétravail, sur la question de l’adaptation des pratiques managériales met en lumière le rôle du Manager dans le cadre du Télétravail. Il indique à cet effet que : « Le manager, accompagné par sa hiérarchie, a un rôle clé dans la mise en œuvre opérationnelle du télétravail, notamment parce qu’il assure ou participe à la fixation des objectifs du salarié. Il favorise ainsi le dialogue professionnel sur les pratiques de télétravail et sur l’articulation entre le télétravail et le travail sur site pour chacun des salariés et au sein des communautés de travail. Il est également un des garants du maintien du lien social entre le salarié en télétravail et l’entreprise ». Cet accord défend le principe suivant lequel le télétravail repose sur un postulat fondamental, la relation de confiance entre un responsable et chaque salarié en télétravail et deux aptitudes complémentaires l’autonomie et la responsabilité nécessaires au télétravail. C’est dans ce but que le Manager est invité à : - la définition d’objectifs clairs, - la résolution de dysfonctionnements éventuels, - l’évaluation de la bonne répartition de la charge de travail et - la bonne réalisation des missions. Ainsi, les responsabilités affectés au Manager dans le cadre du Télétravail, en l’occurrence l’évaluation de la charge de travail et la gestion de l’autonomie du salarié, participe á une meilleure gestion de l’usage des TIC, et par conséquent à une meilleure prise en charge du droit à la déconnexion du salarié. De même, la loi travail 2016 précise que « l’employeur qui élabore une charte pour combler la carence de la négociation collective, doit assurer la mise en œuvre, à destination
- 51. 50 du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques». Cette disposition suppose une responsabilisation du Manager dans la mise en œuvre du droit á la déconnexion, précisément par l’adaptation des pratiques managériales à un usage raisonnable des outils numériques Les contributions de la littérature sur le sujet, convergent sur le rôle important du Management dans la réalisation du droit á la déconnexion. Pour DUMAS ET RUILLER77 , 2014 « le manager socialement responsable ne devrait pas appeler les salariés hors du temps de travail ». Par ailleurs, comme en témoigne une étude de Moustapha ZOOUINAR et NATHALIE PROST (2015) les pratiques des cadres sont largement influencées par celles de leurs managers. Cette étude montre que, certains cadres se connectent de façon (quasi) permanente parce qu’ils ils éprouvent une injonction à répondre rapidement aux sollicitations, en particulier celles de managers qui envoient des messages en heures non ouvrables. Les auteurs expliquent que pour ces cadres, ne pas se connecter régulièrement, c’est prendre le risque d’être sanctionnés ou mal considérés par la hiérarchie. Cette situation fait écho à l’inégalité à laquelle fait référence Jauréguiberry (2014) entre les cadres qui auraient le privilège de choisir s’ils veulent ou non se déconnecter (les managers), et ceux qui sont assujettis à suivre les pratiques de leurs supérieurs. Les TICS seraient ici à relier à des rapports de pouvoir et de culture dans l’organisation. L’accord de la société TOTAL sur le droit à la déconnexion78 (2018), nous donne une appréciation concrète du rôle du responsable hiérarchique dans l’exercice du droit à la déconnexion. Il dispose expressément que le responsable hiérarchique doit encourager ses collaborateurs á ne pas utiliser les outils du numérique à usage professionnel en dehors du temps de travail. Une liste exhaustive des obligations de ce dernier prévoit entre autre qu’il : - Doit montrer l’exemple - Ne doit pas utiliser le courriel comme mode unique de management 77 LE TÉLÉTRAVAIL : LES RISQUES D'UN OUTIL DE GESTION DES FRONTIÈRES ENTRE VIE PERSONNELLE ET VIE PROFESSIONNELLE , Marc Dumas, Caroline Ruiller Management Prospective Ed. | « Management & Avenir » 2014/8 N° 74 | pages 71 à 95 78 En son article 5.2 Rôle des hiérarchies dans l’exercice du droit á la déconnexion
- 52. 51 - Ne doit pas imposer aux collaborateurs d’emporter leur outil numérique à usage professionnelle en dehors des heures de travail - Ne doit pas contacter les collaborateurs sur leur téléphone personnel - Ne doit pas demander un travail obligeant le collaborateur à travailler le soir, le weekend ou pendant les congés - Doit s’assurer que la charge de travail et les objectifs fixés n’impliquent pas un non- respect de la durée du travail et sont compatibles avec le droit à la déconnexion - Etablir un dialogue avec les collaborateurs en difficulté avec l’exercice de leur droit á la déconnexion De ce qui précède, on peut considérer que le Manager représente un maillon essentiel dans la diffusion et de la mise en œuvre du dispositif relatif à l’exercice du droit á la déconnexion. Toutefois, plusieurs travaux tendent à retenir une coresponsabilité du salarié, à défaut de laquelle l’effectivité du droit á la déconnexion est menacée. b- Au niveau du salarié / un devoir de déconnexion Le rapport B. METLING s’est prononcé en faveur d’un devoir de déconnexion à l’égard du salarié de manière à envisager une coresponsabilité de ce dernier et de l’employeur. A ce sujet, le rapport mentionne que la capacité à se déconnecter dépend des rapports de chaque individu au temps, fonction de sa personnalité (spontané, routinier, organisé, etc.), qui mettent longtemps à se construire mais sont plutôt stables. Ainsi la capacité individuelle à se déconnecter se traduirai par exemple, au niveau des usages numériques par des règles de joignabilité ponctuelles en fonction des contextes de travail, par la séparation des adresses courriels ou des numéros de mobile personnel et professionnel, par des usages cloisonnés des réseaux sociaux numériques, etc. Mr LOIC LEROUGE (2017) adhère à cette analyse du rapport. Pour lui, l’intérêt de cette compétence individuelle à se déconnecter réside souvent dans le peu d’emprise de l’employeur sur la liberté individuelle des salariés dont la volonté est de se connecter quoiqu’il arrive. Il rappelle par ailleurs l’obligation de sécurité du salarié de l’article L. 4122 du Code du travail qui préside à ce devoir de déconnexion car chaque salarié à l’obligation «
- 53. 52 de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées ». Francis JAUREGUIBERRY, dans son rapport DEVOTIC79 (2014) décrit justement les conduites de déconnexion volontaires comme celles visant à éviter de rentrer dans la zone rouge du burn out et de subir des situations de surcharge informationnelle insupportables. Il s’agit par exemple pour le salarié de « mettre sur off son téléphone portable dans certaines circonstances ou plages horaires, de déconnecter son logiciel de courrier électronique en choisissant de ne l’interroger que de façon sporadique, d’accepter de ne pas être constamment branché sur ses réseaux sociaux, ou de refuser d’être géolocalisable où que l’on soit » La CFDT CADRES partage cette idée de devoir de déconnexion et sensibilise ses membres dans ce sens. A cet effet, elle rappelle dans sa plaquette dédiée, « Droit et devoir de déconnexion », le droit qu’à chacun de se déconnecter mais aussi le devoir de le faire vis à vis de ses collègues. A l’attention de ses cadres, Elle indique ceci : « Nous pouvons devenir un « pollueur » en puissance quand nous répondons à nos mails à toute heure du jour et de la nuit ». Elle insiste sur la réalité du caractère subjectif du besoin de déconnexion et sur la nécessité d’écouter son entourage sur leur perception de ce besoin ». La CGT se montre plus réservée sur la question du devoir de déconnexion. Se fondant sur l’obligation de sécurité opposée à l’employeur et prévu par l’article 4121 80 du code du travail, celle-ci défend l’idée que c’est l’employeur qui est garant de l’organisation du travail et de la santé des salariés, et que de ce fait , il doit mettre en œuvre un droit à la déconnexion, sans faire basculer sa responsabilité sur les salariés en invoquant un devoir de déconnexion. Pour cette dernière, pour rendre effectif et possible le droit à la déconnexion, il faut s’assurer que l’organisation et la charge de travail du salariée concernée le permet 79 Francis Jauréguiberry. Déconnexion volontaire aux technologies de l’information et de la communication. [Rapport de recherche] Agence Nationale de la Recherche. 2014. hal-00925309 80 L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes
- 54. 53 CHAP IV. Problématique et hypothèse de recherche A travers notre revue de littérature, nous pouvons voir que la réalité du droit à la déconnexion pour le télétravailleur revêt des facettes différentes. D’un point de vue, sa réalisation effective dépend de la charge de travail, de l’organisation du travail ou encore du degré d’autonomie du salarié, d’un autre point de vue, elle dépend du respect de certaines dispositions de l’entreprise et du management. Une autre position encore est celle de la nécessaire conjugaison de ce droit avec un devoir de déconnexion du salarié pour en garantir l’effectivité. Un tel contexte nous convainc de chercher à répondre à cette question : De quel acteur d’entreprise, relève la responsabilité de l’effectivité du droit à la déconnexion dans le cadre du télétravail ? Pour répondre à cette question, nous poserons l’hypothèse suivant laquelle : l’effectivité du droit à la déconnexion relève de la responsabilité de L’entreprise. Une étude qualitative menée auprès d’un échantillon de télétravailleurs nous permettra de vérifier notre hypothèse, notamment en faisant le lien entre les conditions de son effectivité et le vécu des télétravailleurs concernant l’exercice de leur droit à la déconnexion
- 55. 54 TROISIEME PARTIE : METHODOLOGIE DE RECHERCHE Afin de vérifier ou d’infirmer notre hypothèse, nous avons choisi de mener une étude qualitative au soutien d’une enquête réalisé sur la base d’un guide d’entretien semi directif composé de 4 thèmes. A cet effet, notre objectif est de confronter le vécu des salariés dans leur rapport au droit a la déconnexion afin d’identifier les conditions son effectivité. Nous avons à ce titre constitué un échantillon de 10 télétravailleurs salariés et à ce titre, nous avons ciblé une variété de métiers et d’entreprises afin d’éliminer tous biais potentiels qui y seraient liés et de refléter une diversité dans les opinions et les ressentis par rapport au droit à la déconnexion. Nous recherchions non pas une représentation moyenne pour notre échantillon mais un groupe de personnes avec un vécu particulier. Nous avons mobilisé à cet effet notre réseau de connaissances, notamment sur la plate- forme professionnelle LINKEDIN, auprès de nos amis étudiants et de nos amis personnels. Par ailleurs, nous avons utilisé l’instrument GOOGLE FORMS pour réaliser l’enquête auprès de ceux qui n’étaient pas disponible physiquement parce que résidant dans une autre ville, Nous avons aussi pu mener certains entretiens soit par téléphone, soit en présentiel au domicile des personnes qui étaient disponibles. Les répondants ont été invités à s’exprimer en toute latitude sur les 4 thèmes que nous avons abordés au travers d’un guide d’entretien. Un questionnaire a été distribué par le biais de la plateforme Google Forms, des cadres ont été prévus à cet effet sans contrainte d’espace de réponse. Quant aux entretiens en présentiel, les échanges libres et sans contraintes de temps nous ont permis de recueillir le sentiment réel des enquêtés. GUIDE D’ENTRETIEN Thème 1 : Pratique du télétravail 1- Quel est votre métier ? 2- A quelle catégorie socioprofessionnelle appartenez-vous ? 3- Etes-vous salarié au forfait jour ou heures ? 4- A quelle fréquence pratiquez- vous le télétravail ? 5- Où pratiquez- vous le télétravail ? Thème 2 : Degré d’autonomie /équilibre vie professionnelle-vie personnel
- 56. 55 Les résultats de notre enquête qui ont été traité en partie automatiquement dans Google forms, précisément par une traduction en pourcentage des réponses, sous la forme de graphique. Nous avons réalisé une autre partie du travail qui a consisté en une analyse des données, lesquelles ont été confrontés à notre revue de littérature dans notre partie Discussions des résultats. 1- Avez-vous la possibilité de décider de l’ordre d’exécution de vos taches ? 2- Pouvez-vous proposer des alternatives à ce que l’on vous demande sans vous mettre en difficulté 3- Pouvez-vous décider de l’organisation de votre temps de travail ? 4- Recevez- vous souvent des demandes nécessitant des réponses immédiates ? 5- Utilisez-vous votre messagerie et les autres outils numériques pour des raisons professionnelles sur votre temps personnel ? 6- Etes-vous satisfait de l’équilibre de vos temps vie privée vie professionnelle ? Theme 3 : Management et contrôle 1- Comment sont définies vos tâches? 2- Accordez- vous beaucoup de temps au reporting 3- Recevez-vous régulièrement des instructions de votre responsable hiérarchique au cours d’une journée de travail ? Précisez á quelle fréquence si possible ? 4- Quels sont les outils de contrôle utilisés par votre hiérarchie ? Theme 4 : Droit et devoir de déconnexion 1- Quels sont les modes de communication entre vous et votre employeur en situation de télétravail 2- Êtes-vous sollicité par votre employeur en dehors de votre temps de travail (week end, repos, congés, vacances, maladie) ? 3- Vous arrive-t-il de poursuivre vos tâches professionnelles en dehors du temps de travail ? si oui, quels en sont les raisons ? 4- Votre charge de travail est -t-elle la même avec le télétravail 5- Vous arrive-t-il de vous déconnecter volontairement de vos outils numériques professionnels (Messagerie, téléphones, Système Informatique de l’entreprise) 6- Existe-t-il un dispositif en faveur du droit a la déconnexion dans votre entreprise 7- Connaissez-vous des actions concrètes de votre entreprise dans la diffusion du droit à la déconnexion ? 8- Avez-vous déjà abordé la question de la déconnexion avec votre responsable ? si oui, A quelle occasion ? 9- Maîtriser vous les moments et les lieux où vous juger nécessaire de vous déconnecter ou de vous connecter ?
- 57. 56 QUATRIEME PARTIE : PRESENTATION DES RESULTATS Les résultats ci-dessous présentent les tendances qui s’imposent au travers des déclarations de nos enquêtés. Nous avons à ce titre repris les 4 thèmes de notre Guide d’entretien pour en présenter les principaux résultats. CHAP I : la pratique du télétravail - Un Télétravail de Cadres à domicile Tous les répondants sans exception, soit 10 sur 10 rendent compte d’un seul type de télétravail, le télétravail à domicile. Par ailleurs, notre panel est constitué à 70% de cadres dont 30% occupent la fonction d’informaticien, ce qui en fait la représentation métier la plus importante. Le secteur des finances est aussi fortement présent avec un contrôleur de gestion, un auditeur financier, un analyste pricing et un consultant achat, soit 40% de notre échantillon dont 30% de cadres. De même, concernant la fréquence de télétravail, 60% déclare le pratiquer 2 fois par semaine contre 30% qui le pratique au-delà. Parmi ces télétravailleurs intensifs, on note une diversité de profils dont un consultant informaticien qui le pratique sur temps plein soit 5 jours sur 5, un Juriste qui le pratique 4 jours sur 5 et un consultant achat qui le pratique 3 jours sur 5. Notons que ces derniers sont tous cadres. On relève de plus que 100% des cadres sont salariés au forfait jour. Sur la part des non cadres, deux déclarent être au forfait heures dont une stagiaire chargée de projet RH et un employé Technicien Métier RH. CHAP II : Degré d’autonomie/ équilibre vie privée vie professionnelle - Une autonomie relative L’un des principaux objectifs du télétravail est de permettre salarié de concilier ses temps vie privée vie professionnelle, notamment en lui accordant une certaine autonomie dans la prise en charge de ses tâches professionnelles. à ce sujet, tous les interviewés déclarent jouir d’une
- 58. 57 liberté tant dans la gestion de leur tâches que de leur temps de travail. Cependant cette revendication se réalise dans un certain cadre précisément la gestion de contraintes, d’urgences ou de délais. Tels sont les termes employé par la majorité des enquêtés concernant la gestion de l’ordre d’exécution des tâches et du temps de travail. Pour Géneviève, cadre et analyste pricing chez Intermarché: « quand il n’Ya pas de délai oui. Je décide moi-même de l’ordre de mes tâches ». Paulette consultant achat chez PERRSGROUP sur la même question déclare qu’elle s’organise en fonction des urgences. Idem pour Raphael, cadre, informaticien chez BK assurance qui organise son temps de travail: « en fonction des contraintes et des délais de livraison ». Toujours dans la même dynamique, Marc, contrôleur de gestion, employé chez ADECCO répond qu’il organise son temps de travail en fonction de « l’importance des rendus qui sont attendus ». Ainsi, pour la plupart des répondants, l’ordre d’exécution des taches et l’organisation du temps de travail est subordonnée au traitement des urgences, au respect des délais, et de l’importance des tâches. Moise, technicien métier RH nous explique que le traitement des urgences ne lui permette pas toujours d’atteindre ses objectifs tels qu’il les avait prévus dans la journée. Il indique que la nature de son activité implique qu’il soit contacté à tout moment par différents services internes pour la réalisation de diverses prestations. On note ainsi que pour certains métiers, le caractère inopiné de certaines tâches est inhérent à la nature du poste. C’est aussi le cas de Paulette (consultant achat) qui traite directement avec le client en fonction de ses besoins. On note par ailleurs que 100% des interviewés déclarent recevoir des demandes nécessitant des réponses immédiates. La différence réside au niveau de l’estimation de chacun du point de vue de la fréquence ou de l’importance de ces demandes. 70% d’entre eux émettent un oui ferme et catégorique sur le fait de recevoir souvent des sollicitations impliquant des réponses immédiates. Paulette, cadre Analyste financier et Raphael, cadre informatique, témoignent respectivement par « oui régulièrement » et « oui très fréquents, pour des besoins ponctuels ou des anomalies à gérer » Les autres réponses sont plus nuancées, deux cadres répondent « oui parfois » (Steve ingénieur informatique) et « oui par moment » (Geneviève, Analyste
- 59. 58 pricing ». Pour Marc, employé contrôleur de gestion, cela « peut arriver mais pas fréquent ». De même, la plupart des cadres déclarent soumettre toutes formes de propositions ou d’alternatives à la validation préalable de leur manager même s’ils insistent sur l’appréciation de telles démarches par leur Manager. Cette question est importante car l’Autonomie dans le télétravail prend tout autant son sens dans la faculté du salarié à s’approprier la tâche à exécuter, notamment en modifiant l’ordre ou l’instruction de travail sans entacher sa bonne exécution. - Un débordement du travail sur la sphère privée 70% des répondants déclarent utiliser leur messagerie et d’autres outils numériques aux fins professionnelles sur leur temps personnels. 30 % des répondants se positionne par un oui ferme. L’explication de Raphael, ingénieur informatique, à ce sujet semble pertinente. Il affirme que « cela peut arriver lorsqu’on est en retard sur certains travaux. On peut travailler jusqu’à 22 h, 23 h car en tant que cadre, les horaires ne comptent pas, c’est le travail qui doit être fait ». De même Moise technicien métier RH explique que cela lui arrive souvent pour terminer le travail inachevé pendant la journée. Pour 40% cela n’arrive qu’ « assez rarement », « parfois » ou « de temps en temps ». Notons que les réponses négatives concernent une diversité de profil (30%), nous avons un cadre (Géneviève, Analyste pricing), un employé (contrôleur de gestion) et une stagiaire (Camille chargé de projet RH). Par ailleurs, 80% des répondants se déclarent satisfaits de leur équilibre vie privée vie professionnelle, sauf Messieurs KOUAME, cadre, consultant financier et Aubin, cadre, juriste qui indiquent ne pas en être satisfaits. Pour ces derniers le travail empiète fortement sur leur vie privée. Il faut relever que ces deux sont les télétravailleurs les plus intensifs du groupe avec un temps plein pour le premier et 4 sur 5 jours de télétravail pour le second.
- 60. 59 - 90% (9/10) des répondants déclarent poursuivre leurs taches professionnelles en dehors de leur temps de travail. Les retards dans le travail, le respect des délais, les urgences, la charge de travail sont identifiés comme les principales causes. Pour Moise (employé, technicien métier RH) et Raphael (cadre, informaticien), cette situation arrive lorsqu’ils sont en retard dans l’exécution de certains travaux. YOROA (Auditeur financier) déclare ceci : « quand la charge de travail est importante et que les délais sont réduits, précisément en période fiscale », Géneviève (Cadre, Analyste pricing) conclut dans le même sens « oui, si la charge de travail est grande et que les délais sont courts». Pour Steve (Cadre, informatique) et Paulette (cadre, consultant Achat, les raisons sont relativement les mêmes. ils mentionnent respectivement les contraintes de délais et les urgences. Il importe de préciser que le seul répondant ayant répondu par la négative à cette interrogation travaille comme stagiaire (Camille, stagiaire, chargée de projet RH). CHAP III : Management et contrôle Les modalités relatives au management et au contrôle ont été évaluées autour de quatre thèmes, dont les modalités de définition des taches, la fréquence du reporting, le débit auquel le télétravailleur reçoit ses instructions au cours d’une journée et les outils de contrôle. Concernant la définition des tâches, On note une prédominance du mode « par objectifs » soit 80% des répondants, avec un répondant travaillant en mode projet. A ce titre, il explique qu’il travaille « par priorité projet en collaboration avec le reste des équipes projet » (Steve, cadre ingénieur, Naxitis). Pour Raphaël et Geneviève, tous deux cadres, respectivement informaticien et analyste pricing, les tâches sont conduites par priorité. Pour le premier, elles sont fonction des délais de livraison et pour l’autre, elles se réalisent « en fonction des besoins de l’activité, semaine après semaine ». Par ailleurs Le reporting est une tâche présente et régulière pour 40% des répondants dont la majorité (3/4) insiste sur son caractère inhérent à la nature du poste. C’est ce que nous décrit Moise (technicien métier RH, MACIF), Marc (contrôleur de gestion, ADECCO), tous deux employés et YOROA (cadre auditeur financier). Pour un autre cadre, le reporting est prévu
- 61. 60 chaque fin de semaine. On note que cette question concerne les deux employés de notre échantillon. Pour les 60% restant, cette tâche est soit moins présente, c’est le cas de Paulette (cadre, consultant achat) qui y recourt deux heures par semaine et Géneviève (cadre, analyste financier) seulement pour des demandes ponctuelles, soit n’existe pas du tout (40% majoritairement des cadres soit trois quart. De même, les résultats concernant la question de savoir si la journée de télétravail est rythmée par l’intervention régulière du supérieur hiérarchique, les réponses sont pour la plupart nuancés. On peut relever au total 70% de réponses positives. 50% des répondants au profil varié (employé rh, Cadre juriste, cadre consultante Achat Stagiaire RH et cadre Analyste Pricing), déclarent recevoir jusqu’à deux à trois fois par jour des instructions de leur supérieur ou du client. A ce sujet, Géneviève décrit sa situation en ces termes : « Oui. Une sollicitation me prend parfois une bonne partie de la journée donc au maximum 2 ». Pour deux autres, les interventions du supérieur s’inscrivent dans un certain cadre. Marc (employé, contrôleur de gestion) réagit en indiquant ceci : « Mon responsable me contacte suivant le programme des réunions définies à l'avance. Si nous n'avons pas de réunion prévue sur ma journée de télétravail, je ne suis pas sollicité ». Pour YOROA, auditeur financier, la démarche du supérieur dépend des périodes et de l’importance des missions qui lui sont assignées. 30% représentant exclusivement des cadres déclarent ne pas recevoir régulièrement d’instructions de leur supérieur hiérarchique au cours d’une journée de télétravail. Concernant les outils de contrôle utilisés par leur hiérarchie, 30% des répondants déclarent soit qu’il n’en existe pas (10%), soit qu’ils n’en ont pas connaissance (20%).Sur la liste de la part des 70% figurent, les outils de contrôle suivant : Teams (3 répondants), skype, outlook, badgeage numérique, outil interne de saisine des heures de travail, fiche de temps, planning hebdomadaire.
- 62. 61 CHAP IV : Droit et devoir de déconnexion Le thème du droit à la déconnexion, tel qu’il a été abordé par nos répondants, nous permet de mettre en évidence plusieurs tendances concernant les résultats. - Ainsi, en premier lieu, nous constatons qu’il existe une diversité de moyens de communication entre le responsable et son salarié en télétravail. Cependant l’email se distingue comme étant le moyen privilégié. 60% des répondants déclare l’utiliser dans les échanges avec leurs responsables dans le cadre du télétravail. Par ailleurs, on note que chaque répondant sans exception utilise au moins deux outils de communication. ils désignent à cet effet, teams, skype, les appels vidéo, le téléphone, la messagerie instantanée ou tchat. - 100% des répondants témoignent de l’absence de sollicitations de leur responsable en dehors des horaires de travail. Certains ont répondus par le terme « Jamais » pour bien confirmer cette situation. - Pour 60% des répondants, la charge de travail a augmenté avec le télétravail. Steve (cadre, informatique) réagit a cet effet : «La charge de travail a augmentée, le nombre de réunion et de points de coordination ayant augmenté ». Pour Paulette (cadre, consultant achat) « Elle a augmenté car j'excède parfois mon temps de travail normal ». la part des 40% déclare qu’elle reste inchangée. Ainsi pour Marc (employé, contrôleur de gestio), répond ceci : « Ma charge de travail est la même. Elle est restée inchangée. J'ai une liste d'objectifs bien définie que je dois suivre et réaliser mensuellement » - On note que la déconnexion volontaire aux outils numériques professionnels est une réalité pour 70% des répondants. Cependant la plupart déclare que cela n’arrive qu’en dehors du temps de travail. Steve (ingénieur informatique) déclare se déconnecter volontairement « seulement le weekend end afin de respecter un temps de coupure », Raphael( cadre informatique), Yoroa (cadre, auditeur financier) et Geneviève (cadre, analyste pricing) précisent que cette situation n’arrive qu’une fois la journée de travail terminée. Quant à Kouamé (consultant informatique), télétravailleur à temps plein, lui, se déconnecte volontairement pour se protéger d’un trop plein de tâches. 30%,
- 63. 62 représentés par deux employés et une stagiaire disent ne pas en ressentir le besoin. (Moise, Marc et Camille) - Sur la connaissance de dispositif et d’actions concrètes de l’entreprise en faveur de la diffusion du droit à la déconnexion, la majorité des répondants affirment soit qu’il n’y a aucun dispositif, soit qu’ils n’en ont en pas connaissance et qu’ils ne connaissent aucune action de leur employeur en faveur de la diffusion du droit a la déconnexion. C’est le cas de 70% d’entre eux. Marc, employé chez ADECCO et Moise, employé chez MACIF sont certains de l’existence d’un accord sur le télétravail et le droit a la déconnexion dans leur entreprise sans en connaitre le contenu, ni les dispositions éventuelles sur leur droit á la déconnexion. ils déclarent aussi ne pas avoir connaissance de quelconques actions de leur employeur dans ce sens. Par contre Steve (cadre a Naxistis), mentionne l’existence d’une charte de bonne conduite au titre du dispositif et l’organisation de webinaires et la référence dans les mails du droit a la déconnexion comme actions concrètes de son entreprise. Kouamé, Cadre chez Epsilon, indique que son entreprise utilise des messages de rappel sur la nécessité de se déconnecter quand pour Camille, ce sont des messages d’avertissement qui se déclenchent lorsqu’on se connecte en dehors des horaires de travail. - De même, 70% des répondants expliquent ne jamais avoir abordé la question de la déconnexion avec leur Manager. Cependant, deux répondants relèvent que, sans aborder précisément la question de la déconnexion, leur manager les encourage à ne pas se connecter en dehors des horaires de travail. D’un autre côté, deux autres déclarent que le sujet intervient à l’ occasion de leur entretien annuel.
- 64. 63 CINQUIEME PARTIE : DISCUSSIONS DES RESULTATS Notre étude nous permet de mettre en évidence trois principaux résultats à savoir : - une pratique de Télétravail rendant difficile l’exercice du « Droit à la déconnexion », notamment par une gestion inadaptée de l’autonomie du télétravailleur, de la charge et de l’organisation du travail - un moindre investissement de l’entreprise dans la mise en œuvre des responsabilités qui sont les siennes dans la prise en charge de la question - le droit à la déconnexion est un sujet peu maîtrisé des salariés. CHAPI : Une pratique du télétravail hostile à l’exercice du droit à la déconnexion § Une autonomie relative Le télétravail nous offre un réel paradoxe. D’un côté il induit le brouillage des frontières entre vie privée et vie professionnelle et d’un autre, il se conçoit comme un moyen de conciliation de ces deux sphères. C’est cette dernière attribution qui exige que soient réunies plusieurs conditions dont l’autonomie du télétravailleur. L’autonomie du télétravailleur implique pour ce dernier une certaine flexibilité dans l’organisation et l’exécution de ses tâches. Elle se conçoit en lui accordant la possibilité de définir lui-même les tâches qui seront nécessaires à l’atteinte de ses objectifs, d’en modifier l’ordre d’exécution, de s’adapter à des situations changeantes afin de prendre des décisions plus pertinentes pour résoudre le problème rencontré dans son travail ( J.F Chantal 2003 in Pontier 2014). L’autonomie s’entend aussi de la possibilité pour le télétravailleur d’interrompre sa journée de travail plus tôt et de reprendre plus tard le travail. L’autonomie revêt une importance capitale dans la mesure où elle permet au travailleur de réguler plus efficacement son utilisation des TICS. Il s’agit donc d’un critère essentiel à la prise en charge du droit á la déconnexion, notamment en accordant au salarié une certaine
- 65. 64 discrétion dans ses choix de connexion et dans l’organisation de ses temps de déconnexion. C’est en cela que l’article sur 1222-10 du code du travail sur le télétravail, la définition es plages horaires durant lesquelles le salarié peut être joint est pertinent. Par ailleurs Pour être exploité de façon efficiente elle doit se conjuguer avec un autre indicateur « la définition d’objectifs » clairs, et contribuer ainsi à un usage raisonnable des TIC, par une réduction des mails ou des sollicitations diverses du manager via les outils numériques. Nos résultats ne tranchent pas en faveur de cette description de l’autonomie. En effet, nos répondants, cadres en grande majorité salarié au forfait jour dont les tâches sont définis par objectifs, correspondent á l’image même du salarié autonome. Cependant, le constat est que ceux-ci, dans leur grande majorité sont régulièrement soumis à la gestion d’urgences, de contraintes inopinées, au traitement fréquent et immédiat de demandes diverses dans l’exécution de leur tâches. De même, pour la plupart, la prise d’initiatives est subordonnée à la validation préalable du Manager. Cette situation est de nature à annihiler l’autonomie qu’ils revendiquent pourtant dans leur déclaration. Pour les cadres dont les tâches sont définies par priorité ou en fonction des urgences, une réelle difficulté d’autonomie se pose, le caractère imprévisibles des tâches doublée de l’intervention régulière du supérieur hiérarchique menace grandement la réalisation effective du droit à la déconnexion Par ailleurs, le contrôle exercé par la hiérarchie existe bel et bien. Une diversité d’outils de contrôle confine le salarié dans une discipline horaire identique au travail sur site. Cette réalité éloigne le salarié de l’objectif de flexibilité des tâches et de conciliation des temps assignés au télétravail. La grande majorité des salariés ne se permette de se déconnecter qu’en dehors des heures de travail. De plus, les salariés ont conscience que les outils de communication entre eux et leur Manager servent tout autant de moyens de contrôle. Teams, Skype, la messagerie instantanée sont identifiés comme tels et peuvent représenter de ce fait des parades incontestables et efficaces utilisées par le Manager pour exercer son contrôle et causées le maintien du salarié en connexion permanente.
- 66. 65 Nos résultats viennent donc confirmer la thèse de plusieurs auteurs (Pontier 2014, TASKIN ; TREMBLAY 2010 ; BOBILLER 2003) selon laquelle les nouvelles technologies peuvent s’apparenter à des technologies de contrôle du fait de la possibilité technique de surveiller à la fois l’activité et les déplacements des salariés. Elles contribueraient même à une hausse du contrôle. Toute cette situation rend difficile la mise en autonomie du salarié, élément essentiel à une meilleure prise en charge du Droit á la déconnexion de ce dernier. § Une mise en cause de la charge – de l’organisation de travail dans le débordement du travail sur la sphère prive Le télétravail est un facteur de brouillage des frontières entre vie privée et vie professionnelle. Il implique à cet effet un débordement du travail sur la sphère privée, notamment en incitant les salariés à prolonger indéfiniment leurs taches professionnelles sur leur temps personnel (DUMAS ET RUILLER 2014- GENIN 2009- DARES 2018). La charge de travail se trouve elle aussi augmentée. Cette réalité est plus importante pour les télétravailleurs du domicile, lesquels sont exposés au risque plus important de travailler au-delà des horaires de travail et d’avoir des horaires irréguliers. C’est cette situation que révèlent nos résultats. La quasi-totalité de nos répondants soit 9 sur 10 tous télétravailleurs à domicile poursuivent leurs tâches professionnelles au-delà de leurs horaires de travail. La charge de travail associée au délai d’exécution est identifiée à ce titre comme la cause réelle de ce débordement sur la sphère privée. Par ailleurs, une majorité des répondants, 60% tous cadres, estiment que la charge de travail a augmenté avec le télétravail, certains le ressentent au travers de l’augmentation du nombre de réunions et des points de coordination, d’autres par le constat d’une augmentation du temps de travail. Ce constat tend a confirmé la thèse de la nécessaire adéquation entre temps de travail et charge de travail dans l’exercice du droit à la déconnexion. ( B. Metling 2015, CFDT), la durée du travail n’étant plus un indicateur suffisant dans la prise en compte de la question. A ce sujet, la proposition est de la CFDT est congruente. Elle consiste en « une bonne évaluation de la charge de travail de chacun, en amont de toute solution apportée à la déconnexion afin
- 67. 66 qu’elle soit adaptée à un temps de travail raisonnable en vue d’empêcher des besoins réguliers de reconnexion ». Cette position est d’autant plus pertinente pour nos répondants, quasiment tous rémunéré au forfait jour. Ces derniers ne sont normalement pas astreints à la configuration normale de temps de travail journalier d’où le caractère inefficace de la mesure du temps de travail dans l’appréciation du droit à la déconnexion. L’article 3121-65 du code du travail relatif au télétravail a le mérite de prévoir dans une convention individuelle de forfait jour des obligations pour l’employeur tenant à l’établissement d’un document de contrôle déterminant le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, a la compatibilité entre charge de travail du salarié et temps de repos quotidien et hebdomadaire, a la tenue une fois par an d’un entretien avec le salarié concernant sa charge de travail, son caractère raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle. Cette disposition relative au télétravail sert manifestement les intérêts du droit à la déconnexion. Au même titre que la charge de travail, La nécessité d’une bonne organisation de travail telle que le défend la CGT Cadres pour rendre effectif le droit á la déconnexion s’inscrit au regard de nos résultats comme un élément essentiel dans la mise en œuvre du droit à la déconnexion. En effet, une partie non négligeable de nos répondants, soit 40% déclarent que la charge de travail reste inchangée. On constate de ce fait que ce n’est donc pas toujours la charge de travail en soi qui est en cause dans le débordement du travail sur les temps privés mais plutôt la gestion des urgences et des contraintes de délai. La définition d’ objectifs clairs et précis au plus proche de l’exécution des taches afférentes à leur réalisation, tout en participant à la mise en autonomie du salarié, s’avère être une bonne modalité d’organisation du travail, permettant ainsi de pallier à des situations de sollicitations urgentes et inopinées et d’éviter des débordements sur la sphère privée. La réponse d’un de nos répondants tend à confirmer l’efficacité d’une telle solution ; Marc, contrôleur de gestion, indique ceci : « Ma charge de travail est la même. Elle est restée inchangée. J'ai une liste d'objectifs bien définie que je dois suivre et réaliser mensuellement ».
- 68. 67 C’est à juste titre que cette solution est identifiée par la littérature scientifique et la loi comme un moyen de régulation de l’usage des TIC, notamment , en rendant le télétravailleur plus autonome. On note que 100% des répondants déclarent qu’ils ne sont pas contactés durant leurs temps de repos ou de congés par leur supérieur hiérarchique. On peut donc déduire que le défaut de sollicitation de l’employeur en dehors des temps de repos n’empêche pas le salarié de vivre ce débordement du travail qui se trouve justifié par une incompatibilité entre charge de travail et temps de travail et une organisation de travail démunie d’objectifs bien identifiés et ponctuée par le traitement de demandes urgentes et imprévues. §3 Une connexion entre satisfaction des temps et fréquence de télétravail Nos résultats attestent du caractère avéré du débordement du travail sur la sphère privée en télétravail ; Ceci en considération des faits suivants, la poursuite des travaux au-delà des horaires de travail, une connexion permanente qui perdure au-delà des horaires de travail, et l’utilisation par la majorité des répondants des outils numériques pour des raisons professionnelles sur leur temps personnels. Si l’intérêt pour le « droit à la déconnexion » se trouve légitimé dans un tel contexte, on constate néanmoins que 80% de nos répondants se déclarent satisfaits de leur équilibre vie privée vie professionnelle. Ce sont pourtant ces mêmes qui vivent ce débordement du travail sur leur temps de repos, notamment par une augmentation de la charge de travail et une organisation soumise à la gestion d’urgences et de contraintes. La part de ceux qui s’estiment insatisfaits de leur équilibre des temps sont les deux télétravailleurs intensifs de notre échantillon avec 4 sur 5, et 5 sur 5 jours de télétravail. Ils estiment que leur vie professionnelle empiète fortement sur leur privée. La fréquence de télétravail se positionne donc comme un indicateur important dans la satisfaction des temps et partant dans l’appréciation des besoins de déconnexion des salariés. De plus, la question de la fréquence de télétravail est le seul indice qui les distingue réellement des autres répondants. D’un côté ce résultat pourrait trouver son explication dans le fait que ces télétravailleurs subissent de façon plus importante les effets pervers du télétravail, en l’occurrence le
- 69. 68 brouillage des frontières. Ils ressentent plus intensément l’augmentation de la charge de travail comme ils le témoignent dans leur déclaration. Par ailleurs l’isolement permanent associé à la perte du lien social pourrait représenter un paramètre á prendre en compte dans ce ressenti d’insatisfaction des temps. D’un autre côté, la plupart des répondants se déclarant satisfaits de leur équilibre vie privée vie professionnelle ne pratiquent le télétravail que 2 jours par semaine. Il s’agit du nombre de jours recommandé pour bénéficier des avantages du télétravail, notamment pour éviter les risques d’isolement et profiter des gains de productivité (CAS 2009). On note ainsi que le débordement du travail sur les temps de repos, vécu par ces télétravailleurs n’a nullement entamer leur équilibre des temps du fait d’une pratique raisonnable du télétravail. Si l’employeur et le salarié peuvent fixer librement les modalités du télétravail, notamment sa fréquence, nos résultats montrent qu’il est important de considérer les conséquences d’un télétravail trop régulier dans la prise en charge du droit à la déconnexion. L’isolement, la perte du lien social, le défaut d’interactions avec les autres sont autant de facteurs qui empêchent la réalisation du droit à la déconnexion, notamment du point de vue des actions de sensibilisation ou encore dans la prise en compte des besoins du salarié sur la question. On conçoit difficilement qu’un télétravailleur se sentant exclut du collectif puisse communiquer aisément sur ses difficultés et de même se laisser convaincre par une démarche de l’entreprise sur le sujet de la déconnexion. CHAP II : Des responsabilités mal assumées par l’entreprise et le Management Nos résultats sur le thème du droit à la déconnexion nous ont permis d’évaluer la connaissance des répondants sur le sujet, précisément au travers des initiatives de communication de leur entreprise et de leur Manager. Comme le prévoit les dispositions légales en la matière, (2247 du code du travail, art 17 accord collectif sur la QVT, ANI 2020 sur la mise en œuvre réussie du télétravail), il est confié à l’entreprise et au Management plusieurs responsabilités dans la mise en œuvre du droit à la déconnexion.
- 70. 69 Pour l’entreprise, elles concernent avant tout de participer au dialogue social sur la négociation annuelle obligatoire relative à l’égalité professionnelle entre hommes et femmes, en inscrivant au sein d’un accord collectif ou d’un accord d’entreprise ou à défaut d’accord, au sein d’une charte, les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion. L’entreprise doit à cet effet prévoir la mise en place de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques mais aussi des actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques à l’endroit du salarié et du personnel encadrant. En confrontant le cadre posé ci-dessus à nos résultats, nous pouvons conclure soit à une absence d’investissement ou d’engagement de l’entreprise dans la diffusion du droit à la déconnexion auprès des salariés, soit à une approche qui s’avère inefficace. En effet une grande majorité des répondants déclarent soit qu’il n’y a aucun dispositif, soit qu’ils n’en ont en pas connaissance et qu’ils ne connaissent aucune action de leur employeur en faveur de la diffusion du droit à la déconnexion. Cette situation est étonnante dans la mesure où notre échantillon est constitué en grande partie de salarié d’entreprises comptant en moyenne plus de 200 salariés, certain intervenant au sein de groupes tel que ntermarché et Adecco. Ces grandes entreprises se distinguent 81 par un dialogue social actif facilité par la présence de représentations syndicales. On aurait donc pu s’attendre à une plus grande sensibilisation des salariés sur la question étant donné que ses conditions de mise en œuvre sont confiées à la négociation collective. Par ailleurs, c’est au sein de ces entreprises que le télétravail est le plus développé et que le droit à la déconnexion revêt une certaine importance. Il est important d’indiquer que cette distance des entreprises par rapport au sujet du droit à la déconnexion peut résulter d’un choix, car si la négociation annuelle est obligatoire, l’entreprise n’est nullement obligée de s’engager au travers d’un accord, elle n’est pas lié par l’avis des représentants du personnel. Par ailleurs, l’absence de charte n’est pas sanctionnée. Une recherche sur l’existence d’accords ou de chartes dans les entreprises de nos répondants sur le thème du droit à la déconnexion, rend compte des différences d’approches vis-à-vis du sujet. Pour certaines entreprises, on note un engagement affirmé au travers de l’existence ’un 81 https://www.legifrance.gouv.fr/acco/id/ACCOTEXT000041846441?init=true&page=1&query=droit+ a+la+deconnexion+ADECCO&searchField=ALL&tab_selection=all
- 71. 70 accord ou d’une Charte avec des modalités précises d’exercice du droit à la déconnexion dont, formation et sensibilisation sur le droit à la déconnexion, l’envoi de guide de bonne pratique d’utilisation des mail, atelier de Détox numérique , implication de la ligne managériale, (ADECCO82 , NAXITIS83 ) tandis que pour d’autres , il n’existe qu’un seul paragraphe en guise de mention de l’existence d’un droit à la déconnexion ( Intermarché84 ). On constate de même que l’existence de dispositif formel ne garantit pas nécessairement une acculturation des salariés à la question. C’est le cas de notre répondant salarié de ADECCO qui déclare ne connaitre aucune action concrète de son entreprise sur le sujet même s’il reçoit des encouragements de son manager à ne pas se connecter en dehors des heures de travail. Cette situation peut être interpréter comme un défaut de communication sur le sujet ou constituer en elle-même l’approche choisie par l’entreprise pour faire face à ses engagements en la matière car c’est aussi le cas pour un autre répondant qui explique que son responsable n’accepte pas qu’il se connecte hors de ses temps de travail. Pour deux autres répondants, s’ils n’ont connaissance d’aucun dispositif sur la diffusion du droit à la déconnexion, ils abordent néanmoins la question avec leur manager au cours de leur entretien annuel de fin d’année. Cette question intervient certainement dans le cadre l’obligation opposée à l’employeur d’organiser chaque année un entretien qui porte notamment sur les conditions d’activité et la charge de travail du salarié en télétravail. (article 1222-10 du code du travail). On peut saisir ici le rôle important du Manager, notamment, du point de vue de ses attributions mais aussi de sa proximité avec le télétravailleur dans l’accomplissement des tâches, et partant de l’impact que celui peut exercer sur ce dernier selon l’orientation qu’il voudra bien donner au traitement de la question. Les attributions du manager font de lui un canal essentiel à la diffusion du droit á la déconnexion car il intervient sur toutes les zones susceptibles d’influencer de façon négative 82 https://www.legifrance.gouv.fr/acco/id/ACCOTEXT000041846441?init=true&page=1&query=droit+ a+la+deconnexion+ADECCO&searchField=ALL&tab_selection=all 83 https://www.maitredata.com/app/accords-entreprise/natixis-lease/21686Natixis reconnaît un droit individuel à la déconnexion permettant à chacun de concilier au mieux vie professionnelle et vie privée, une charte intitulée « pour un bon usage des e-mails » (est affichée sur le Portail RH dans la rubrique « work & life at Natixis ».Cette charte recommande notamment d’être sélectif dans le choix de ses destinataires, d’être attentif à la clarté et à la concision de ses messages, de privilégier le contact direct pour les sujets sensibles, de ne pas envoyer de message en dehors des horaires habituels de travail, sauf urgences, et invite à se déconnecter notamment le week-end et pendant les périodes de congés. 84 https://www.legifrance.gouv.fr/acco/id/ACCOTEXT000043649205?init=true&page=1&query=DROIT+A+LA+DECONNEXION+IN TERMARCHE&searchField=ALL&tab_selection=all
- 72. 71 ou positive les conditions de mise en œuvre du télétravail et du droit á la déconnexion. Ainsi la définition des objectifs, la détermination de la charge de travail, la gestion des conditions d’activités sont orchestrées par ce dernier. Aussi, c’est à juste titre que la loi85 .prescrit la révision des pratiques managériales en adéquation avec les exigences du télétravail et du droit à la déconnexion. Par ailleurs, tout comme les salariés l’employeur se doit de former et de sensibiliser les managers à un usage raisonnable des TICS. Plusieurs accords (collectifs, entreprises) mettent l’accent sur l’exemplarité dont le Manager doit faire preuve dans l’utilisation des TICS, sur son rôle de sensibilisation et d’animation sur le sujet mais aussi d’écoute, notamment auprès des travailleurs qui rencontrent des difficultés dans l’exercice de ce droit. Nos résultats traduisent l’existence d’une dynamique managériale quasi inexistante en matière de droit á la déconnexion. On doit néanmoins reconnaitre que le Manager n’est que le porteur de la politique de l’entreprise, à laquelle est imputé la responsabilité de définir la ligne managériale sur la question, de former et de sensibiliser les managers a la prise en charge de la question. Pour 30% des répondants, les actions concrètes de l’entreprise existent, il s’agit de messages de rappel ou d’avertissement en cas de connexion aux mails en dehors des horaires de travail ou encore de webinaire sur le sujet. On relève néanmoins que 20% d’entre eux déclarent vivre un débordement du travail sur ses temps privés, précisément par le fait d’une charge de travail plus importante. La charge de travail s’impose donc comme une menace réelle du droit à la déconnexion, notamment en neutralisant les effets potentiels de ces initiatives de l’entreprise sur les salariés. CHAP III : Déconnexion : un sujet peu maîtrisée des salariés La grande majorité de nos répondants restent connectés en permanence sur le temps officiel de travail et certains ne jugent nécessaire de se déconnecter que lorsqu’ils ont largement débordé sur leur temps de repos. Par ailleurs la plupart indiquent n’avoir aucune emprise sur 85 ANI 2020
- 73. 72 les temps de déconnexion. Cette situation transmet le défaut d’une réelle autonomie du télétravailleur. On relève par ailleurs que pour certains, le statut de cadres impliquent de ne pas compter ses heures de travail et de rendre, au mépris de son temps de repos, le travail qui est demandé. Il s’agit d’une conception qui mérite une certaine correction car cela témoigne du manque d’éducation des répondants sur la question de la déconnexion. Le manque d’éducation de nos enquêtés notamment par le défaut de sensibilisation sur le sujet ne leur permet pas de développer des compétences personnelles dans la maîtrise du devoir de déconnexion qui leur est opposé au sein de nombreux accords d’entreprise et qui est suggéré par le rapport B Metling (2015). Si la reconnaissance d’un devoir de déconnexion semble justifié du point de vue de l’autonomie acquise en Télétravail dans l’organisation de ses tâches, ou encore du fait que l’employeur ne peut avoir une complète maîtrise sur la sphère privée dans le cadre du télétravail à domicile, il revient à l’employeur de lui fournir les moyens nécessaires à son émancipation sur le sujet Il semble donc important de sensibiliser davantage le télétravailleur sur les implications de son droit à la déconnexion avant de pouvoir lui imputer un devoir de déconnexion car en toute logique un droit ne vaut que pour celui qui s’en prévaut et cela ne peut se réaliser sans connaissance du sujet qui doit en faire l’objet. SIXIEME PARTIE : RECOMMANDATIONS En considération des résultats ci-dessus, nous faisons les recommandations suivantes : 1- Rendre au salarié une réelle autonomie en privilégiant le management par objectifs et régler les désordres organisationnels : l’autonomie est un critère liée intrinsèquement à l’atteinte de l’objectif principal assigné tant au télétravail qu’au droit à la déconnexion : la conciliation entre vie privée et vie professionnelle. Une autonomie effective du télétravailleur se révèle dans la liberté qui lui est laissée dans l’organisation de ses taches et dans leur ordre d’exécution, dans le choix de ces moments de connexion ou de déconnexion. Pour se faire, le Management par objectifs
- 74. 73 se distingue comme le moyen le plus efficace. Il s’agit à cet effet de définir dans le cadre d’un dialogue professionnel des objectifs clairs et précis, qui pourraient se décliner sur des périodes hebdomadaire ou mensuelle aux échéances desquelles seulement, un point avec le Manager pourrait intervenir, précisément sur l’atteinte de ces objectifs. Une telle approche pourrait régler tant les désordres organisationnels liés aux sollicitations fréquentes du manager par le biais des TIC, à la gestion d’urgences, à l’augmentation de la charge de travail induite par des réunions fréquentes, des temps de reporting important. Ce sont toutes ces situations qui amènent à un usage non raisonnable des TICS et qui menacent de ce fait le droit á la déconnexion 2- Faire de La mesure de la charge de travail un sujet de dialogue professionnel : la charge de travail est identifiée comme une cause majeure dans le non-respect du droit á la déconnexion et sa perception peut varier d’un salarié à un autre. C’est pourquoi, il est nécessaire d’associer le salarié à sa définition. Il est important d’en faire un sujet de dialogue régulier au moins à l’occasion des réunions visant à faire le point sur l’atteinte des objectifs dans le cadre ci-dessus prévu. Par ailleurs la charge de travail mentale liée à une gestion régulière d’urgence, a une disproportion entre le travail prescrit et le travail réel ou encore á l’insuffisance ou la non pertinence des moyens mis à la disposition du travailleur pour effectuer la tâche, doit intégrer cette mesure. 3- Prévoir une phase d’expérimentation en limitant la fréquence de télétravail a 2 jours pour les débutants afin d’évaluer le rapport du salarié au droit á la déconnexion : l’employeur et le salarié sont libres de déterminer la fréquence de télétravail. Cependant, En considération des risques d’un télétravail régulier, notamment dans l’exercice du droit à la déconnexion, une phase d’expérimentation pour les débutants semble nécessaire, ceci pour s’assurer de leur compétence à gérer leur usage des TIC de façon raisonnable. 4- Faire du droit à la déconnexion, un indicateur de performance individuelle et collective : en créant par exemple une plate-forme d’échanges d’expérience entre les salariés sur le sujet, en retenant les meilleurs exemples à suivre et en les diffusant dans l’entreprise. Cette démarche permettrai de sortir le sujet de la zone tabou car pour beaucoup de salarié, se déconnecter ou ne pas répondre aux mails ou sollicitations
- 75. 74 diverses pendant ses temps de repos, c’est témoigner d’un moindre investissement dans son travail et risquer d’être mal considéré par sa hiérarchie. 5- Créer des référents télétravail et droit à la déconnexion au sein de l’entreprise de sorte à permettre au salarié en difficulté de profiter d’un regard différent de celui de son manager : Cette recommandation tire sa légitimité des incompréhensions ou désaccords éventuels qui pourraient survenir entre salarié et Manager, susceptibles d’impacter le dialogue sur les questions de la charge de travail , de l’organisation ou des difficultés ressenties par le salarié dans l’exercice de son droit á la déconnexion. Un tiers, avec une connaissance sur le sujet pourrait intervenir en qualité de facilitateur du dialogue ou encore d’éclaireur sur certaines zones grises. 6- Ouvrir des campagnes de sensibilisation, de communication sur le sujet afin d’armer davantage les salariés qui sont confrontés à un déni potentiel de leur droit à la déconnexion : En ignorant les implications de leur droit á la déconnexion, les salariés ne peuvent s’en prévaloir et représenter un contre poids valable face aux transgressions dont ils pourraient être victimes. 7- Former les salariés sur des techniques pour mieux gérer le stress face aux outils numériques : en les encourageant à organiser les priorités de la journée, a Réapprendre à se faire plaisir et à penser à soi, a ne pas vouloir poursuivre son travail à tout prix quand les heures de bureau sont dépassées depuis longtemps. L’entreprise pourrait, pour rendre la démarche plus ludique, organiser des apéro formations et échanges sur les pratiques de déconnexion ou encore proposer des abonnements en salle de sport pour évacuer le stress.
- 76. 75 CONCLUSION. Comme nous avons pu le constater au travers de notre étude, le télétravail offre au « droit à la déconnexion » un cadre privilégié d’expression. Nos résultats montrent que le « droit à la déconnexion » du télétravailleur est effectivement menacé du fait d’un débordement du travail sur les temps privés par l’usage des TIC. Nous avons pu identifier les causes de cette situation, notamment une charge de travail incompatible avec le temps imparti, une organisation de travail mal rodée, une autonomie du salarié en souffrance, une fréquence importante de télétravail. Ces résultats positionnent l’entreprise comme un acteur majeur dans la prise en charge de la question car les solutions potentielles pour lever ces entraves au « droit à la déconnexion » relèvent en partie de ses compétences. Par ailleurs, notre recherche traduit un moindre engagement de l’entreprise dans la responsabilité qui lui est dévolue, malgré un cadre légal riche de ressources et des syndicats actifs sur la question. Ainsi, l’entreprise ne s’investit que timidement, partiellement ou pas du tout dans son rôle de mise en place des dispositifs de régulation de l’usage des TICS, de sensibilisation ou encore d’information du salarié sur le contenu et les implications de son droit à la déconnexion. Au travers de l’entreprise, c’est le management qui est fortement mobilisé en déclinant la politique de l’entreprise, les accords ou chartes sur la question en actions concrètes. Ainsi en toute logique, tout comme l’entreprise, nos résultats témoignent d’une absence du Management dans la diffusion du droit à la déconnexion. Notre recherche témoigne donc de la nécessaire implication de l’entreprise dans la réalisation du « droit à la déconnexion ». Toutefois elle ne rend pas compte d’une responsabilité exclusive de celle-ci dans l’effectivité de ce droit. La responsabilité conféré au salarié, notamment au travers d’un devoir de déconnexion semble justifié au regard de son obligation de santé et de sécurité envers lui-même, laquelle s’impose davantage lorsqu’il travaille dans un cadre dont il assume seul la maîtrise, s’agissant précisément du domicile. Une autre raison réside dans l’autonomie qui lui est offert en télétravail à travers la possibilité d’organiser et de gérer ses temps de travail, de s’occuper de charges personnels pendant les
- 77. 76 heures habituelles de travail et de reprendre le travail plus tard. Une telle situation est de nature à lui laisser une certaine discrétion dans l’exercice de son droit à la déconnexion. Cependant, le devoir d’information, et de sensibilisation confié à l’entreprise par la loi se positionne comme un préalable, a défaut duquel on ne peut légitimement opposer au télétravailleur un devoir de déconnexion. De ce côté, nos résultats démontrent une dynamique quasi inexistante de l’entreprise, qui aurait malheureusement tendance à justifier les débordements vécus par les télétravailleurs sur leur temps privés au même titre que la charge, l’organisation et la fréquence de télétravail. Il convient de relever que la fiabilité de notre étude repose sur la diversité des métiers et des entreprises représentés au travers de nos répondants. Cette réalité nous permet d’avoir une vision relativement concrète de la manifestation du droit à la déconnexion en entreprise, tout au moins du point de vue du salarié. Cependant, comme toute étude qualitative, elle ne nous permet pas de faire d’estimation statistique. Il aurait été intéressant d’analyser le vécu de salariés exerçant d’autres formes de télétravail. Par ailleurs, une enquête auprès des responsables et Managers d’entreprises, par une confrontation des vécus nous aurait confortés davantage dans nos analyses. Nous pourrions envisager de poursuivre notre étude dans ce sens. Il convient de noter pour finir que les entreprises Françaises font face à une question toute nouvelle vis-à-vis de laquelle elles sont en plus pionnières. On peut donc s’attendre, avec la montée annoncée du télétravail a une évolution de leurs compétences sur le « droit à la déconnexion » qui est en phase d’être adopté dans tous les pays de l’union européenne.
- 78. 77 Bibliographie Annick Schott, A. S. (2019). Connexion raisonnée : droit à la déconnexion et autres responsabilités, le cheminement d’un délibéré d’une pme girondine. ANDESE | « Vie & sciences de l’entreprise », 2019/2 N° 208, 55‑71. https://www.cairn.info/revue-vie- et-sciences-de-l-entreprise-2019-2-page-55.htm Arnaud Scallerez, A. S., & Danielle Gabrielle Tremblay, D. G. T. (2016). Le télétravail, comme nouveau mode de régulation de la flexibilisation et de l’organisation du travail : analyse et impact du cadre légal européen et nord-américain. ESKA | « Revue de l’organisation responsable », Vol. 11(2016/1), 21‑31. https://www.cairn.info/revue- de-l-organisation-responsable-2016-1-page-21.htm Bruno Metling, B. M. (2015, septembre). Transformation numérique et vie au travail. https://vie-publique.fr Cabinet Harris Interactive, & Ministère de l’emploi et de l’insertion. (2020, novembre). L’activité des francais pendant le confinement. https://Google.fr Caroline Diard C.D., & Nicholas Dufourt, N.D. (2021). Dans quelle mesure les accords d’entreprise permettent-ils de prévenir les risques liés au télétravail ? (2021). ESKA | « Revue de l’organisation responsable », Vol. 16(2021/1), 25‑37. https://www.cairn.info/revue-de-l-organisation-responsable-2021-1-page-25.htm Centre d’analyse Stratégique (CAS), & Cabinet Roland Berger. (2009, novembre). Le développement du télétravail dans la société numérique de demain. https://Google.fr Direction de l’animation de la recherche, des évolutions et de la statistique, D. A. R. E. S. (2004). LE TÉLÉTRAVAIL EN FRANCE : 2 % de salariés le pratiquent à domicile, 5 % de façon nomade. DARES Premières synthèses informations, 51.3. https://dares.travail-emploi.gouv.fr
- 79. 78 Direction de l’animation de la recherche, des évolutions et de la statistique, D.A.R.E.S. (2018). Quels liens entre les usages professionnels des outils numériques et les conditions de travail ? DARES Analyses, 029. https://dares.travail-emploi.gouv.fr Direction de l’animation et de la recherche, des évolutions et de la statistique D. A. R. E. S. (2019). Quels sont les salariés concernés par le télétravail. DARES Analyses, 051, 1‑ 11. https://dares.travail-emploi.gouv.fr Emilie Genin, E. G. (2014). Quels facteurs influencent la satisfaction des cadres à l’égard de l’équilibre des temps (personnel et professionnel) ? Association de Gestion des Ressources Humaines | « @GRH », 2014/1 n° 10, 87‑107. https://www.cairn.info/revue-agrh1-2014-1-page-87.htm Emmanuelle Gril, E. G. (2020). Diagnostic. HEC Montréal, 45 (2020/3), 113‑114. https://www.cairn.info/revue-gestion-2020-3-page-113.htm Francis Jaureguiberry, F. J. (2010). Pratiques soutenables des technologies de communication en entreprise. De Boeck Supérieur | « Projectics / Proyéctica / Projectique », 2010/3(6), 107‑120. https://www.cairn.info/revue-projectique-2010-3-page-107.htm Francis Jaureguiberry, F. J. (2019). Désir et pratiques de déconnexion. C.N.R.S. Editions | « Hermès, La Revue », 2019/2 n° 84, 98‑103. https://www.cairn.info/revue-hermes-la- revue-2019-2-page-98.htm Jean Luc Metzger, J. L. M. (2009). Focus - les cadres télétravaillent pour. . . mieux travailler. Caisse nationale d’allocations familiales | « Informations sociales », 2009/3(153), 75‑ 77. https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2009-3-page-75.htm Laurent Taskin, L. T., & Diane Gabrielle Tremblay, D. G. T. (2010). Comment gérer des télétravailleurs. Gestion, 35(2010/1), 88‑96. https://www.cairn.info/revue-gestion- 2010-1-page-88.htm
- 80. 79 Laurent Taskin, L. T. (2010). La déspatialisation, enjeu de gestion. Lavoisier | « Revue française de gestion », 2010/3 n° 202, 61‑76. https://www.cairn.info/revue-francaise- de-gestion-2010-3-page-61.htm Loïc Le Rouge, L. L. R. (2018). Le droit à la déconnexion a la française. HAL.archives ouvertes. Published. https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01508793 Marc Dumas, M. D., & Caroline Ruiller, C. R. (2014). Le télétravail : les risques d’un outil de gestion des frontières entre vie personnelle et vie professionnelle ? Management Prospective Ed. | « Management & Avenir », 2014/8 N° 74, 71‑95. https://www.cairn.info/revue-management-et-avenir-2014-8-page-71.htm Marc Eric Bobiller, & Chaumon. (2003). Evolutions techniques et mutations du travail : émergence de nouveaux modèles d’activité. Presse Universitaire Française, 66(2003/2), 161-192. https://www.cairn.info/revue-le-travail-humain-2003-2-page- 161.htm Ministère chargé de l’industrie, de L’énergie et de l’économie numérique, & Cabinet Greenworking. (2012, mai). Le télétravail dans les grandes entreprises françaises comment la distance transforme nos modes de travail. https://Google.fr Monique Haicault, M. H. (1998). Travail à distance et/ou travail à distance : Télétravail. https://halshs.archives-ouvertes.fr. https://halshs.archives-ouvertes.fr Monique Pontier, M. P. (2014). Télétravail indépendant ou télétravail salarié : quelles modalités de contrôle et quel degré d’autonomie. Monique Pontier Direction et Gestion | « La Revue des Sciences de Gestion », 2014/1(265), 31‑39. https://www.cairn.info/revue-des-sciences-de-gestion-2014-1-page-31.htm Nathalie Boonen, N. B., & Groupe CESI. (2017). Il y a une vie après le boulot ou comment vivre déconnecté. cahiers de la documentation, 2017/2.
- 81. 80 Observatoire du Télétravail et de l’Ergostressie (OBERGO), Yves Lafargues, Y. L., & Sylvie Fauconnier, S. F. (2018). Impact du télétravail 2018, de plus en plus de qualité et de productivité avec de moins en moins de fatigue et de stress. https://Google.fr Pierre Morel A l’Huissier. (2007). Du télétravail au travail mobile, un enjeu de modernisation de l’économie francaise. https://vie-publique.fr Simon Nora, S. N., Alain Minc, A. M., & Présidence de la République, P. R. (1978, janvier). L’informatisation de la Société. https://www.vie-publique.fr/rapport/34772- linformatisation-de-la-societe Soufyane Frimousse, S. F., & Jean-Marie Peretti, J. M. P. (2020). Regards croisés, Les répercussions durables de la crise sur le management. EMS Editions | « Question(s) de management », 2020/2 n° 28, 159‑243. https://www.cairn.info/revue-questions-de- management-2020-2-page-159.htm Valérie Fernandez, V. F., Caroline Guillot, C. G., & Laurie Marrauld, L. M. (2014). TÉLÉTRAVAIL ET « TRAVAIL À DISTANCE ÉQUIPÉ » Quelles compétences, tactiques et pratiques professionnelles ? Lavoisier | « Revue française de gestion », 2014/1(238), 101‑118. https://www.cairn.info/revue-francaise-de-gestion-2014-1- page-101.htm Textes et loi Code du travail, https://www.legifrance.gouv.fr/ Accord-cadre sur le télétravail signé par la CES, l'UNICE/UEAPME et le CEEP le 16 juillet 2002, https://www.greenworking.fr Accord National interprofessionnelle relatif au télétravail du 19 juillet 2005, https://www.anact.fr
- 82. 81 Accord National interprofessionnel sur la Qualité de vie au travail du 19 juin 2013, https://www.anact.fr/accord-national-interprofessionnel-du-19-juin-2013-relatif-la- qualite-de-vie-au-travail Accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020 sur une mise en œuvre réussie du télétravail, https://www.cadrescfdt.fr Ordonnance N° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000035607388/ Résolution du Parlement européen du 21 janvier 2021 contenant des recommandations à la Commission sur le droit à la déconnexion (2019/2181(INL) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0021_FR.html





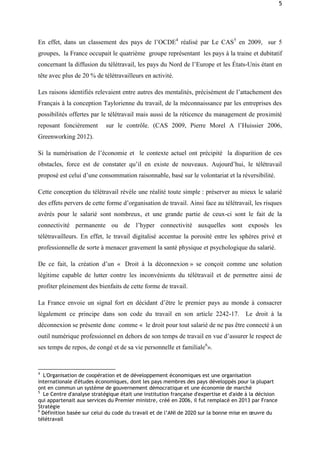




















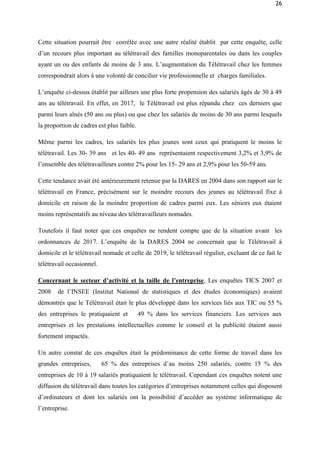



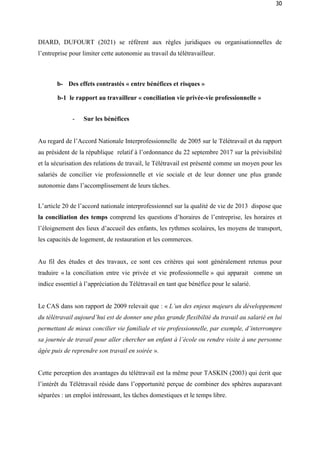
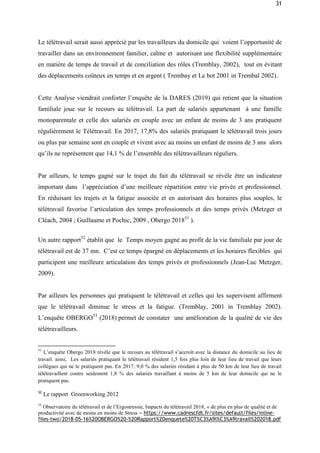

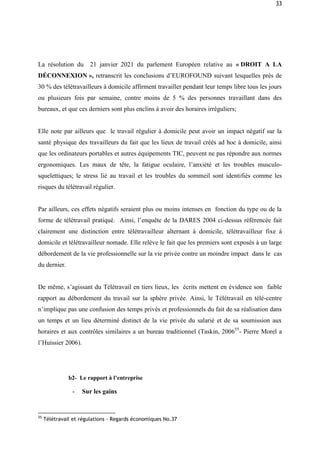


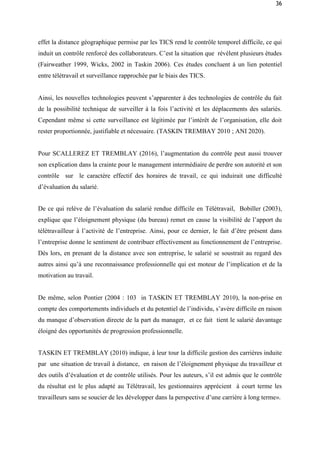
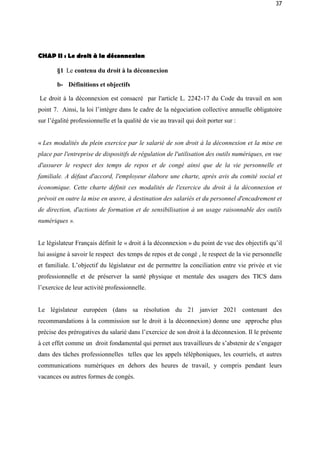














![52
de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa
sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées ».
Francis JAUREGUIBERRY, dans son rapport DEVOTIC79
(2014) décrit justement les
conduites de déconnexion volontaires comme celles visant à éviter de rentrer dans la zone
rouge du burn out et de subir des situations de surcharge informationnelle insupportables. Il
s’agit par exemple pour le salarié de « mettre sur off son téléphone portable dans certaines
circonstances ou plages horaires, de déconnecter son logiciel de courrier électronique en
choisissant de ne l’interroger que de façon sporadique, d’accepter de ne pas être
constamment branché sur ses réseaux sociaux, ou de refuser d’être géolocalisable où que l’on
soit »
La CFDT CADRES partage cette idée de devoir de déconnexion et sensibilise ses membres
dans ce sens. A cet effet, elle rappelle dans sa plaquette dédiée, « Droit et devoir de
déconnexion », le droit qu’à chacun de se déconnecter mais aussi le devoir de le faire vis à vis
de ses collègues. A l’attention de ses cadres, Elle indique ceci : « Nous pouvons devenir un «
pollueur » en puissance quand nous répondons à nos mails à toute heure du jour et de la
nuit ». Elle insiste sur la réalité du caractère subjectif du besoin de déconnexion et sur la
nécessité d’écouter son entourage sur leur perception de ce besoin ».
La CGT se montre plus réservée sur la question du devoir de déconnexion. Se fondant sur
l’obligation de sécurité opposée à l’employeur et prévu par l’article 4121 80
du code du
travail, celle-ci défend l’idée que c’est l’employeur qui est garant de l’organisation du travail
et de la santé des salariés, et que de ce fait , il doit mettre en œuvre un droit à la déconnexion,
sans faire basculer sa responsabilité sur les salariés en invoquant un devoir de déconnexion.
Pour cette dernière, pour rendre effectif et possible le droit à la déconnexion, il faut s’assurer
que l’organisation et la charge de travail du salariée concernée le permet
79
Francis Jauréguiberry. Déconnexion volontaire aux technologies de l’information et de la
communication.
[Rapport de recherche] Agence Nationale de la Recherche. 2014. hal-00925309
80
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique
et mentale des travailleurs.Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.
4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des
circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes](https://image.slidesharecdn.com/versionfinale-memoire-220817124624-c2f7673e/85/LE-DROIT-A-LA-DECONNEXION-DANS-LE-CADRE-DU-TELETRAVAIL-EN-FRANCE-pdf-53-320.jpg)