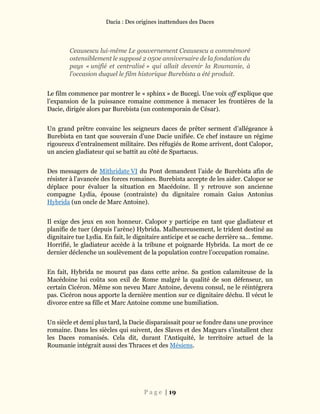Dacia : Des origines inattendues des Daces
- 1. Dacia
- 3. Dacia : Des origines inattendues des Daces Licence : Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Autoéditeur : carioulibrairie.wordpress.com Publication : 2025 | première édition Du même auteur : 1. Scythia : L'étonnante Histoire de l'antique Irlande (2018) 2. Brittia : L’Histoire méconnue des Bretons 3. Keltia : L’étrange Histoire des Celtes 4. Nâga : L'Histoire de la population nâga 5. Maya : L’Histoire de la population maya 6. Luzia : L’Histoire ancienne du Nouveau Continent 7. Gaia : La Préhistoire revisitée 8. Koya : Les indices de la "génohistoire" 9. Sela : Des témoignages historiques surréels (2019) 10. Troia : L’Histoire de la Nouvelle-Troie 11. India : Les origines de l’Inde (2020) 12. Namaka : Les origines des peuples antiques 13. Europa : Les origines des Européens 14. Brittia II : Du Kalimantan à la Bretagne 15. NRYN : L’origine inconnue de notre humanité (2021) 16. Scythia: The Amazing Origins of Ancient Ireland 17. Ibéria : L’énigme proto-ibère 18. Furia : Les deux guerres mondiales décodées 19. Tè Ra : Quand l’Histoire dépasse la fiction 20. Origins of the Celts (sous le pseudonyme Cryfris Llydaweg, 2022) 21. Futuria : Le futur proche décodé 22. Edda : Le "space opera" norrois 23. Atlantia : L'énigme proto-atlante (2023) 24. Nysa : La première conquête 25. Druidéa : Des origines insolites de la culture celte (2024) 26. Amunet : Des origines obscures de l’Egypte antique 27. Ĕlāhā : Evolution ou évolution créative ? (2025) 28. Bellone : La rivalité protohistorique entre la Grèce et l’Inde 29. Dacia : Des origines inattendues des Daces Autres essais : o Napoléon B. L'interview (2022) o de Mirepoix. L’interview o Europe antique. Un glossaire (2023)
- 4. o Ancient Europe. A glossary o Leabar Gabala. La suite o J. Churchward. Un glossaire o Anna Vreizh. L’interview
- 5. Dacia : Des origines inattendues des Daces P a g e | 1 Introduction Le lien entre « Daces » et « Gètes » est discuté. La plupart des historiens roumains et moldaves les dénomment « Gèto-Daces » ou « Gètodaces », arguant que « Gètes » est leur nom grec et « Daces » leur nom latin, mais une minorité considère qu’il s’agit de deux peuples distincts : les Daces à l’ouest des Carpates, les Gètes à l’est. Quoi qu’il en soit, au sud de l’Hæmos, les sources antiques ne parlent plus de Daces ou de Gètes mais de Thraces sans autre précision, et là aussi les historiens débattent pour savoir si Daces, Gètes et Thraces formaient un même peuple ou des populations différentes. Wikipédia Les Daces occupaient un territoire qui correspond à la Roumanie (dont les rives occidentales de la mer Noire) et à la Moldavie actuelles. Les Romains nommaient leur pays sous le nom latin (latinisé ?) de Dacia. Ce dernier découle de l’ancien grec Dáoi (Wiktionary). Nous traduisons librement le paragraphe d’un article de Wikipédia. Le nom Daci, ou « Daces », est un ethnonyme collectif. Dio Cassius rapporte que les Daces eux-mêmes utilisaient ce nom, et que les Romains les appelaient ainsi, tandis que les Grecs les appelaient Getae. Si les Daces se nommaient sous ce nom, pourquoi des Grecs antiques les désignaient-ils sous le vocable Gètes ? Pourtant, le grec ancien disposait des termes Dáoi et Dákoi. Hérodote n’échappe pas à cette règle. On cite son introduction sur les Gètes. Avant que d’arriver à l’Ister [Danube], les Gètes, qui se disent immortels, furent les premiers peuples qu’il subjugua. Les Thraces de Salmydesse, et ceux qui demeurent au-dessus d’Apollonie et de la ville de Mésambrin, qu’on appelle Scyrmiades et Nipséens, s’étaient rendus à lui sans combattre et sans faire la moindre résistance. Les Gètes, par un fol entêtement, se mirent en défense ; mais ils furent sur-le-champ réduits en esclavage.
- 6. Dacia : Des origines inattendues des Daces P a g e | 2 Ces peuples sont les plus braves et les plus justes d’entre les Thraces. Les Massagètes venaient des steppes eurasiennes (selon l’archéologie), les Tyragètes provenaient de Sarmatie (selon des géographes grecs), etc. Comment peut-on les assimiler (via des « Gètes ») à des Daces ?
- 7. Dacia : Des origines inattendues des Daces P a g e | 3 Les origines Illustration de l’auteur Le premier contact connu entre la société grecque et des populations riveraines de la mer Noire remonterait à la colonisation grecque (734-580 avant notre ère). Cette dernière fonda plusieurs ports : Istros, Tomis, Odessos, etc. On ignore le nom des populations locales en question (nommées géto-daces à défaut de mieux). Par contre, l’archéologie sait que des liens culturels se forgèrent entre colons et locaux. À propos de Tomis, nous citons un article de Wikipédia sur la ville roumaine Constanța (rive occidentale de la mer Noire). Le nom de Constantiana lui a été donné par l’empereur romain Constantin Ier (274-337) en l’honneur de sa sœur Constantia. Auparavant la cité se nommait en grec ancien Tomis ou Tomes signifiant « tranché », qui selon les archéologues et historiens Theodor Capidan, George Vâlsan et Adrian Rădulescu aurait désigné la forme du port antique, aujourd’hui enfoui sous la gare maritime moderne, qui tranchait la ligne côtière, à l’ouest de ce qui était alors la presqu’île de Tomis. Le panthéon dace diffère totalement de son homologue grec. Un personnage, Zalmoxis, le domine. On cite l’article Wikipédia sur le sujet.
- 8. Dacia : Des origines inattendues des Daces P a g e | 4 La « demeure souterraine » où Zalmoxis disparut et vécut trois ans pour reparaître ensuite afin de prêcher aux Gètes l’immortalité de l’Homme n’a cependant rien de chamanique. Cette « demeure souterraine » pourrait être une grotte du mont sacré Kogaionon cité par les mêmes sources. À l’issue de son ermitage, Zalmoxis enseignait aux participants lors de ses « banquets » (autrement dit son culte à Mystères) que tous iraient en un lieu où ils survivraient toujours et jouiraient d’une complète félicité. On passe sur l’assimilation Dáoi et « Gètes » dans cet article. Pour revenir à Zalmoxis, Hérodote soupçonnait son appartenance au genre humain. Je ne rejette ni n’admets ce qu’on raconte de Zalmoxis et de son logement souterrain, mais je pense qu’il est antérieur de bien des années à Pythagore. Au reste, que Zalmoxis ait été un homme, ou que ce soit quelque dieu du pays des Gètes, c’en est assez sur ce qui le concerne. Il reste une question : si ces Daces diffèrent des Gètes, d’où viennent-ils ? Pour y répondre, une question peut s’avérer décisive. Comment le grec ancien désigne-t- il les Dahae ? Il utilise au moins cinq vocables : Dáoi, Dáai, Dai, Dai, Dasai. Sur cette population, on cite l’article Wikipédia. Les Dahae formaient une confédération de trois nations scythes : les Parni, les Xanthii et les Pissuri, qui vivaient dans une région comprenant une grande partie du Turkménistan moderne et du Nord-Est de l’Iran. Demeurons-nous les seuls à envisager une origine scythe des Daces ? Comment peut-on passer à côté des Dáoi-Daces et des Dáoi-Dahae ?
- 9. Dacia : Des origines inattendues des Daces P a g e | 5 Les Dahae Monnaie d’un atelier monétaire présumé Dahae (région incertaine) | Collection de la Bibliothèque nationale de France | Domaine public On les connait pour leur participation à des conflits au côté des Sakas et des Achéménides et contre Alexandre le Grand. Quelques décennies après l’épopée d’Alexandre, ils occupent la Parthie et fondent l’empire parthe. Nous traduisons librement quelques sections d’un article Wikipédia. Selon l’historien babylonien Bérose, le fondateur de l’empire perse achéménide, Cyrus, serait mort en combattant les Dahae. Selon l’iranologue Muhammad Dandamayev, Bérose a identifié les Dahae plutôt que les Massagètes comme les assassins de Cyrus parce qu’ils avaient remplacé les Massagètes en tant que tribu nomade la plus célèbre d’Asie centrale bien avant l’époque de Bérose, bien que certains érudits aient identifié les Dahae comme étant identiques aux Massagètes ou comme l’un de leurs sous-groupes. Une tradition évite enfin les assimilations entre Gètes et Dahae.
- 10. Dacia : Des origines inattendues des Daces P a g e | 6 À la fin du IVe siècle et au début du IIIe siècle avant notre ère, les Dahae, et en particulier leur tribu constitutive des Parni, se sont installés le long des franges sud et sud-ouest du désert de Karakum, et au milieu du IIIe siècle avant notre ère, ils se sont déplacés vers l’ouest et se sont installés le long des rives sud-est de la mer Caspienne, dans les terres situées au nord de l’Hyrcanie. Ils s’installent donc sur les rives sud-est de la mer Caspienne au milieu du 3e siècle avant notre ère. Dans ce cas, comment peuvent-ils s’implanter sur celles de la mer Noire à l’époque de la colonisation grecque (734-580 avant notre ère), soit plusieurs siècles plus tôt ? En fait, à l’époque d’Hérodote, les Grecs ne connaissaient pas les Daces-Dahae car ces derniers arrivèrent sur des rives de la mer Noire après le 3e siècle (avant notre ère). Notre point de vue se récapitule ainsi : les Daces se résument à des Dahae expatriés et hellénisés au contact de colonies grecques riveraines de la mer Noire, fondées plusieurs siècles avant l’arrivée de ces migrants. Au cours du IIe siècle avant notre ère, les Dahae, qui vivaient encore dans les steppes, et l’Empire parthe, ainsi que les Chorasmiens et les Sogdiens ont envoyé des ambassades à l’empereur Wu de la dynastie Han, qui régnait alors sur la Chine. Si ces Dahae pouvaient se permettre de voyager en Chine (à l’est), ils pouvaient aussi s’offrir la Grèce (à l’ouest). Notre point de vue pourrait donc s’affiner : ils envoyèrent (dans un premier temps) des ambassades dans des colonies grecques.
- 11. Dacia : Des origines inattendues des Daces P a g e | 7 Zalmoxis Le Casque d’Or de Coțofenești. Une théorie propose un antique propriétaire : Zalmoxis | Photographe : Jorge Láscar | Licence : CC BY 2.0 On revient à un personnage dace, Zalmoxis, connu d’Hérodote comme une figure gète. Nous pouvons déduire deux choses. Les (Massa ?) Gètes précédèrent les Daces sur les rives de la mer Noire. On rappelle que les Dahae détrônèrent les Massagètes comme tribu nomade la plus célèbre d’Asie centrale. Cela souligne donc l’antériorité des Gètes. Enfin, les (Massa ?) Gètes et les Daces se partageaient ce personnage. On cite à nouveau l’article Wikipédia sur ce personnage. Dans l’antiquité, la figure de Zalmoxis est très controversée : certains auteurs affirment qu’il s’agit d’un prince ou d’un roi (Platon, Strabon, Jordanès) ; d’autres affirment que c’est un imposteur divinisé : d’après Hérodote, les Grecs du Pont racontaient que Zalmoxis, avant d’être dieu, avait été homme, esclave et disciple de Pythagore, et qu’il était devenu ensuite le législateur des Thraces, ce qui veut dire sans doute que les Grecs du Pont, retrouvant chez les Thraces certaines pratiques ou légendes analogues à celles des Pythagoriciens, les expliquaient de cette manière.
- 12. Dacia : Des origines inattendues des Daces P a g e | 8 On résume l’énigme : les Grecs du Pont racontaient que Zalmoxis, avant d’être dieu, avait été homme, esclave et disciple de Pythagore. Un homme qui s’élève au rang de dieu reste un grand classique de la protohistoire. Dans d’autres essais, nous soulignons que la terminologie « dieu » désignait avant tout un titre posthume ou un statut social (de son vivant). La condition d’esclave de Zalmoxis reste plus difficile à expliquer. Cela dit, l’archéologie sait que les colonies grecques recourraient massivement à l’esclavage pour leur fondation et leur développement. Pythagore naquit en 580 avant notre ère, soit à la fin de la colonisation grecque. Après plusieurs « initiations » (formations), il fonda sa première école à Crotone (Calabre, Italie). On cite l’article Wikipédia. À Crotone, il aurait rencontré Abaris le Scythe, grand magicien et « chamane ». D’après la Souda, une encyclopédie rédigée en grec médiéval, ce Scythe se résumait à un ambassadeur auprès des Athéniens. Il pratiquait la « magie » mais nous avons déjà souligné (dans notre essai Druidéa) la synonymie entre mage et naturaliste durant la protohistoire. Si un Scythe rencontra Pythagore au 6e siècle avant notre ère, pourquoi un Gète s’en priverait-il ? Cela dit, on rappelle l’élément le plus étrange du parcours de Zalmoxis. La « demeure souterraine » où Zalmoxis disparut et vécut trois ans pour reparaître ensuite afin de prêcher aux Gètes l’immortalité de l’Homme n’a cependant rien de chamanique. Cette « demeure souterraine » pourrait être une grotte du mont sacré Kogaionon cité par les mêmes sources. À l’issue de son ermitage, Zalmoxis enseignait aux participants lors de ses « banquets » (autrement dit son culte à Mystères) que tous iraient en un lieu où ils survivraient toujours et jouiraient d’une complète félicité.
- 13. Dacia : Des origines inattendues des Daces P a g e | 9 On veut bien considérer qu’il devint ermite dans une grotte pendant trois ans. Cela dit, en sortie de grotte, son discours ne relève pas de l’ermitage mais du messianisme. Contrairement au Bouddha, il ne promet pas l’éveil mais l’immortalité. Nous ne parlons pas encore de la résurrection propre au futur christianisme mais on s’en approche. Deux interprétations s’offrent à nous : il oublia ses esprits dans la grotte ou sa personne expérimenta une demeure souterraine pleine de félicité. Comme le discours « il a perdu l’esprit » relève plus de la fainéantise que de la recherche, nous optons pour le chemin le plus difficile.
- 14. Dacia : Des origines inattendues des Daces P a g e | 10 Kogaionon Le sphinx des monts Bucegi, dans les Carpates (Roumanie) | Photographe : Radu Privantu | Licence : CC BY 2.0 D’autres auteurs débutèrent par une recherche sur la situation géographique de la montagne sacrée de la religion dace : Kogaionon. Son étymologie reste inconnue. L’article Wikipédia concerné permet de passer en revue des situations possibles. des sommets des Carpates orientales, à la limite entre la Transylvanie et la Moldavie, autour du tripoint où se rencontrent les județe (départements) de Bacău, de Covasna et de Harghita, parce que ces sommets se trouvent entre les deux vallées de Cașin (nom supposé provenir de Kogaionon) situées l’une en Transylvanie (Covasna), l’autre en Moldavie (Bacău) ; Les Carpates forment la partie orientale d’une chaîne de montagnes au centre de l’Europe, dont les Alpes constituent la partie occidentale. des sommets des monts Bucegi, parce qu’on y trouve les formations calcaires d’érosion éolienne des Babele (« les vieilles » en roumain) et du « Sphinx des Bucegi » (qui, avant que le sphinx d’Égypte n’entre dans la culture populaire roumaine, était
- 15. Dacia : Des origines inattendues des Daces P a g e | 11 appelé simplement capul, « la tête » en roumain, nom rapproché de Kogaionon, bien qu’il provienne du latin caput…) ; Ces monts se situent dans la partie méridionale des Carpates. Concernant le « sphinx », l’article Wikipédia nous éclaire. Le Sphinx des Bucegi est un rocher en forme de tête humaine qui rappelle, sous certains angles, la tête du Sphinx de Gizeh. […] Rapportée par Hérodote, la légende antique évoque une montagne nommée Kogaionon c’est-à-dire « montagne sacrée », qui pourrait être le Sphinx. Kogaionon serait l’endroit où aurait vécu Zalmoxis (…) Strabon rapporta également cette légende. On utilisera la traduction d’Amédée Tardieu (1822-1893) publiée par le site Remacle (livre 7, chapitre 3, section 5). Ainsi l’histoire nous parle d’un certain Gète, nommé Zamolxis, qui, après avoir été esclave de Pythagore et avoir recueilli de la bouche de son maitre quelques notions de la science des astres, complétées plus tard en Égypte, où sa vie errante l’avait amené, revint ensuite dans son pays, y attira l’attention des chefs et du peuple par les prédictions qu’il savait tirer des signes et phénomènes célestes et finit par persuader au roi d’associer à son pouvoir un homme qui, comme lui, pouvait être l’interprète des volontés des Dieux. Il s’était vu alors nommer grand prêtre du Dieu que les Gètes honorent le plus, mais ce n’était là qu’un commencement, et l’on en était venu avec le temps à le considérer lui-même comme Dieu. La « divinité » Zalmoxis se contenta donc d’être un grand-prêtre. Il faut dire qu’ayant trouvé en un lieu inaccessible une caverne profonde il s’y était confiné, n’en sortant plus que rarement et ne communiquant guère qu’avec le roi et ses ministres ; ajoutons que le roi lui-même l’avait aidé à tromper les populations, voyant qu’elles étaient devenues bien plus dociles à ses ordres depuis qu’elles les croyaient dictés par l’inspiration même des Dieux.
- 16. Dacia : Des origines inattendues des Daces P a g e | 12 Seulement, la coutume s’en est perpétuée jusqu’à nous et depuis Zamolxis il s’est toujours trouvé quelque imposteur comme lui prêt à devenir le conseiller du prince régnant et à recevoir des Gètes ce titre de Dieu. Il inaugura ainsi une tradition politique dace qui consistait à impressionner la population si l’autorité politique ne suffisait plus. On apprend surtout que la caverne choisie par Zalmoxis se trouve dans un lieu inaccessible. De même la montagne où Zamolxis s’était retiré et qui de son temps passait pour sacrée est souvent encore aujourd’hui appelée le Mont-Sacré, mais son vrai nom [et il appartient également à la rivière qui passe au pied] est Cogaeonum. Cogaeonum-Kogaionon n’attendit donc pas Zalmoxis pour devenir une montagne sacrée. Cela dit, malgré son métier de géographe, Strabon ne précise pas sa situation géographique. De toute façon, de son point de vue antique, le territoire des Daces se trouvait en « Germanie » méridionale. D’autres pistes géographiques existent dans les Carpates méridionales : le massif calcaire blanc de Piatra Craiului, les monts Făgăraș, etc. Pour avancer, nous avons varié nos combinaisons de mots clés sur des moteurs de recherche et un des résultats nous intrigue.
- 17. Dacia : Des origines inattendues des Daces P a g e | 13 Tomis Ruines de Tomis | Photographe : Andymxm | Licence : CC BY-SA 4.0 Andreea Laza, docteur en philologie (université de Timişoara, Roumanie) gère un blog : 9Pedia. Nous traduisons librement le paragraphe d’un de ses articles. Les monts Bucegi sont un portail d’entrée au centre de la Terre, car un tunnel souterrain y mène à la Terre intérieure ou Agartha. Cependant, cette entrée est protégée par un dôme d’énergie qui ne peut être désactivé et qui ne permet qu’aux humains hautement évolués originaires de ces terres de passer. Les villes souterraines d’Agartha sont Apelos et Tomasis, la première étant située quelque part sous la ville d’Alba Iulia (montagnes Apuseni), et la seconde sous Constanța, en Roumanie (également connue sous le nom de Tomis). Elle cite sa source : Radu Cinamar. On cite sa biographie sur Babelio. Radu Cinamar est l’écrivain qui relata en Roumanie, via les informations transmises par un membre des services secrets, l’incroyable découverte dans les monts Bucegi des Carpates.
- 18. Dacia : Des origines inattendues des Daces P a g e | 14 On s’intéresse donc à sa prose traduite en français. On commence par la maison d’édition : les Éditions Atlantes. Elle publie des ouvrages sur la spiritualité et propose un espace « thérapeute ». On se rend directement à la page de l’auteur. On y découvre cinq ouvrages. Après avoir acheté le premier dès 2021 (Découverte au Bucegi, 2016), on investit dans le troisième (À l’intérieur de la Terre, 2018). En nous basant sur le premier, nous tentons de résumer le parcours (peu banal) du membre des services secrets. Tout commence au printemps 70 dans une maternité roumaine. Le docteur Nenu s’affaire autour de Smaranda Brad qui vient de donner la vie à un garçon. Il ne comprend pas la taille du cordon ombilical (1,50 m). De plus, ses ciseaux « glissent » sur le cordon comme sur du… caoutchouc (?). Finalement, un bistouri en viendra à bout. En fait, malgré sa longue expérience, il panique et alerte la Securitate. Dans un océan de procédures, un colonel lui demande de détruire le dossier médical du nouveau-né et rencontre (un mois plus tard) les parents, Smaranda (passionnée de dessin) et Nicolae (employé de mairie). Il devient le tuteur de l’enfant (une visite mensuelle) et demande aux parents de recourir uniquement à un médecin mandaté. Le petit Cezar prononcera son premier mot à l’âge de… trois ans et deux mois. Durant cette période, il ne tomba jamais malade. Ensuite, ses séances contemplatives (interminables) devant des dessins de sa mère inquiètent les parents. Le médecin détaché se penche sur son cas. Selon lui, tout va bien et l’on doit éviter de perturber l’enfant. Les parents se divisent sur la stratégie à adopter et le couple se fissure. À l’âge de sept ans, il intègre l’école et devient un élève moyen (dans tous les domaines). Un jour, un(e) professeur de poésie (ulcérée) lui demande de réciter le sujet du cours (un poème). Dans la foulée, l’enfant amuse son auditoire en récitant des poésies absentes du manuel. Alors qu’il n’a que dix ans, sa vie bascule. Ses parents le surprennent dans une séance de légère… lévitation (?). Ils ne s’en remettent pas et le jeune Cezar intègre un programme national (1980-1985). Il comprit rapidement qu’il ne reverrait pas
- 19. Dacia : Des origines inattendues des Daces P a g e | 15 sa famille. Officiellement, il n’existe même plus. Ensuite, on l’affecte dans un département du Service Roumain d’Information. Radu Cinamar prétend avoir rencontré Cezar à plusieurs reprises en 2003 dans le cadre d’une fuite (d’information) « orchestrée » par le Service. Selon lui, un an plus tôt, en 2002, Cezar reçut dans son bureau un membre d’un « groupe » international qui disposait de ses entrées au Service. Il s’intéressait aux aptitudes psychiques (peu banales) de Cezar afin de l’intégrer dans un nouveau projet. Ce dernier se résume à l’étude d’archives découvertes aux monts Bucegi au sein une médiathèque « ultramoderne » à flanc de montagne. Une énigme s’ajoute : cette médiathèque date d’au moins quinze… mille ans.
- 20. Dacia : Des origines inattendues des Daces P a g e | 16 Tomassis Illustration de l’auteur Nous ne nous attarderons pas sur le contenu de la médiathèque car cela nécessite des notions en physique que Cinamar et nous ne maitrisons pas. L’auteur tente bien d’éclairer la lanterne de ses lecteurs (et la sienne) mais cela reste laborieux. Nous nous intéressons désormais à son troisième ouvrage : A l’intérieur de la Terre. Dans les deux premiers chapitres, l’auteur tente de nous préparer au troisième. Comme ses concepts en physique s’améliorent, cela devient intéressant. On tente de résumer. Notre planète s’avère ni pleine ni creuse. Si l’on pouvait couper une planète en deux et observer le résultat de l’espace, nous distinguerions deux éléments principaux. Tout d’abord, nous aurions la confirmation que sous la croûte terrestre s’étend un magma. Par contre, au-delà, nous et nos instruments ne distinguerions qu’un corps noir à peine animé par des jets de lumière. Sans rentrer dans les détails des deux chapitres, ce corps noir reste une dimension physique dont l’énergie électromagnétique augmente. Dans cette dimension, les « distorsions » spatiales (voire temporelles) deviennent possibles. Concernant notre planète, son cœur se résumerait à un trou noir, un objet céleste connu pour son champ gravitationnel et ses distorsions de l’espace-temps.
- 21. Dacia : Des origines inattendues des Daces P a g e | 17 Cinamar affirme même que le trou noir reste la pierre de fondation de tous les corps célestes et de toutes les particules… subatomiques. Pour l’instant, on sait qu’un trou noir « aspire » de la matière mais la communauté scientifique ne s’aventure pas (encore) sur le phénomène inverse : la production de matière dédiée à la création de corps et de particules. On parle même d’hérésie au sein de milieux conservateurs. Cela dit, Cinamar consacre son ouvrage essentiellement à la croûte terrestre qu’il décrit comme un gruyère dont certaines cavités s’agrandissent considérablement lorsqu’on s’approche du magma. En fait, des dizaines (voire des centaines) d’entre elles pourraient largement accueillir des mégapoles. Il précise tout de même que plus on descend dans la croûte, plus l’oxygène diminue mais il reste muet sur la source de cet oxygène. Pour revenir à la médiathèque multimillénaire hypothétique des monts Bucegi, elle côtoie deux portails de distorsion spatiale. Accompagné de Cezar, Cinamar emprunte le premier portail. Nous ne détaillerons pas le troisième chapitre car nous ne souhaitons pas priver le lecteur intéressé de la découverte. On précisera simplement la destination du voyage : la cité de Tomassis. On ajoutera tout de même qu’il y rencontrera des descendants de… Daces. On pourrait épiloguer pendant des heures sur la faisabilité à notre époque d’un tel voyage. Nous pensons tout de même que l’antique Zalmoxis ne débitait pas que des inepties.
- 22. Dacia : Des origines inattendues des Daces P a g e | 18 La chute Décébale | Artiste : Ion Popescu-Băjenaru, 1914 | Domaine public À l’époque, la Dacie se déclinait en plusieurs états indépendants. Un de leurs souverains, Décébale (vers 60-106), en fédéra et agressa le territoire romain et obtint de Domitien (51-96) un tribut. Par contre, les états installés le long du Danube commerçaient avec les Romains et s’alliaient volontiers. Rome finança un pont sur le Danube et une conquête (101-106) de la Dacie. Humilié, Décébale se suicida. Ensuite, les Romains exploitèrent (106-271) les mines d’or, d’argent et de sel daces. Nous traduisons librement une section de l’article Wikipédia sur les Daces. L’étude des Daces, de leur culture, de leur société et de leur religion n’est pas seulement un sujet d’histoire ancienne, mais a des implications actuelles dans le contexte du nationalisme roumain. Les positions adoptées sur la question épineuse de l’origine des Roumains et de la mesure dans laquelle les Roumains d’aujourd’hui descendent des Daces peuvent avoir des implications politiques contemporaines. Par exemple, le gouvernement de Nicolae Ceausescu a revendiqué une continuité ininterrompue d’un État dacien-roumain, du roi Burebista à
- 23. Dacia : Des origines inattendues des Daces P a g e | 19 Ceausescu lui-même Le gouvernement Ceausescu a commémoré ostensiblement le supposé 2 050e anniversaire de la fondation du pays « unifié et centralisé » qui allait devenir la Roumanie, à l’occasion duquel le film historique Burebista a été produit. Le film commence par montrer le « sphinx » de Bucegi. Une voix off explique que l’expansion de la puissance romaine commence à menacer les frontières de la Dacie, dirigée alors par Burebista (un contemporain de César). Un grand prêtre convainc les seigneurs daces de prêter serment d’allégeance à Burebista en tant que souverain d’une Dacie unifiée. Ce chef instaure un régime rigoureux d’entraînement militaire. Des réfugiés de Rome arrivent, dont Calopor, un ancien gladiateur qui se battit au côté de Spartacus. Des messagers de Mithridate VI du Pont demandent l’aide de Burebista afin de résister à l’avancée des forces romaines. Burebista accepte de les aider. Calopor se déplace pour évaluer la situation en Macédoine. Il y retrouve son ancienne compagne Lydia, épouse (contrainte) du dignitaire romain Gaius Antonius Hybrida (un oncle de Marc Antoine). Il exige des jeux en son honneur. Calopor y participe en tant que gladiateur et planifie de tuer (depuis l’arène) Hybrida. Malheureusement, le trident destiné au dignitaire tue Lydia. En fait, le dignitaire anticipe et se cache derrière sa… femme. Horrifié, le gladiateur accède à la tribune et poignarde Hybrida. La mort de ce dernier déclenche un soulèvement de la population contre l’occupation romaine. En fait, Hybrida ne mourut pas dans cette arène. Sa gestion calamiteuse de la Macédoine lui coûta son exil de Rome malgré la qualité de son défenseur, un certain Cicéron. Même son neveu Marc Antoine, devenu consul, ne le réintégrera pas. Cicéron nous apporte la dernière mention sur ce dignitaire déchu. Il vécut le divorce entre sa fille et Marc Antoine comme une humiliation. Un siècle et demi plus tard, la Dacie disparaissait pour se fondre dans une province romaine. Dans les siècles qui suivent, des Slaves et des Magyars s’installent chez les Daces romanisés. Cela dit, durant l’Antiquité, le territoire actuel de la Roumanie intégrait aussi des Thraces et des Mésiens.
- 24. Dacia : Des origines inattendues des Daces P a g e | 20 Comme le nationalisme dace ne peut s’appuyer sur une culture (perdue) et une langue (inconnue), un protochronisme s’active en Roumanie. Autrement dit, des auteurs tentent de relier les Roumains aux Proto-Daces. Or, l’archéologie sait que les Daces s’installèrent sur les rives de la mer Caspienne au milieu du 3e siècle avant notre ère. Leur installation sur celles de la mer Noire reste donc plus récente. Comme la protohistoire remonte au moins à cinq siècles avant notre ère, les Proto- Daces se trouvaient alors sur des territoires actuels du Turkménistan et d’Iran, sous le nom célèbre (à leur époque) de Dahae.
- 25. Dacia : Des origines inattendues des Daces P a g e | 21 Conclusion Nous avons tenté de percer le mystère dace et l’on ne s’attendait pas à voyager en Asie et encore moins au « centre » de la Terre. Le fait qu’une population protohistorique intacte puisse encore exister dépasse un peu notre compréhension. De plus, on n’ose imaginer ce qui arrivera si nos dirigeants modernes rencontrent des descendants directs de Proto-Daces dont la technologie rivalise avec la nôtre. On ne parle donc plus de dirigeants européens confrontés à des nations amérindiennes au 16e siècle de notre ère. Ces hypothétiques Daces apportent la preuve que nous pouvions prendre une direction différente dans notre évolution. En fait, ils détiennent même un potentiel d’amélioration ici, à la « surface ».





![Dacia : Des origines inattendues des Daces
P a g e | 1
Introduction
Le lien entre « Daces » et « Gètes » est discuté. La plupart des
historiens roumains et moldaves les dénomment « Gèto-Daces »
ou « Gètodaces », arguant que « Gètes » est leur nom grec et
« Daces » leur nom latin, mais une minorité considère qu’il s’agit
de deux peuples distincts : les Daces à l’ouest des Carpates, les
Gètes à l’est. Quoi qu’il en soit, au sud de l’Hæmos, les sources
antiques ne parlent plus de Daces ou de Gètes mais de Thraces
sans autre précision, et là aussi les historiens débattent pour
savoir si Daces, Gètes et Thraces formaient un même peuple ou
des populations différentes. Wikipédia
Les Daces occupaient un territoire qui correspond à la Roumanie (dont les rives
occidentales de la mer Noire) et à la Moldavie actuelles. Les Romains nommaient
leur pays sous le nom latin (latinisé ?) de Dacia. Ce dernier découle de l’ancien grec
Dáoi (Wiktionary). Nous traduisons librement le paragraphe d’un article de
Wikipédia.
Le nom Daci, ou « Daces », est un ethnonyme collectif. Dio
Cassius rapporte que les Daces eux-mêmes utilisaient ce nom, et
que les Romains les appelaient ainsi, tandis que les Grecs les
appelaient Getae.
Si les Daces se nommaient sous ce nom, pourquoi des Grecs antiques les
désignaient-ils sous le vocable Gètes ? Pourtant, le grec ancien disposait des termes
Dáoi et Dákoi. Hérodote n’échappe pas à cette règle. On cite son introduction sur
les Gètes.
Avant que d’arriver à l’Ister [Danube], les Gètes, qui se disent
immortels, furent les premiers peuples qu’il subjugua. Les
Thraces de Salmydesse, et ceux qui demeurent au-dessus
d’Apollonie et de la ville de Mésambrin, qu’on appelle Scyrmiades
et Nipséens, s’étaient rendus à lui sans combattre et sans faire la
moindre résistance. Les Gètes, par un fol entêtement, se mirent
en défense ; mais ils furent sur-le-champ réduits en esclavage.](https://image.slidesharecdn.com/dacia-250527082838-cfeb07bd/85/Dacia-Des-origines-inattendues-des-Daces-5-320.jpg)









![Dacia : Des origines inattendues des Daces
P a g e | 11
appelé simplement capul, « la tête » en roumain, nom rapproché
de Kogaionon, bien qu’il provienne du latin caput…) ;
Ces monts se situent dans la partie méridionale des Carpates. Concernant le
« sphinx », l’article Wikipédia nous éclaire.
Le Sphinx des Bucegi est un rocher en forme de tête humaine qui
rappelle, sous certains angles, la tête du Sphinx de Gizeh. […]
Rapportée par Hérodote, la légende antique évoque une
montagne nommée Kogaionon c’est-à-dire « montagne sacrée »,
qui pourrait être le Sphinx. Kogaionon serait l’endroit où aurait
vécu Zalmoxis (…)
Strabon rapporta également cette légende. On utilisera la traduction d’Amédée
Tardieu (1822-1893) publiée par le site Remacle (livre 7, chapitre 3, section 5).
Ainsi l’histoire nous parle d’un certain Gète, nommé Zamolxis,
qui, après avoir été esclave de Pythagore et avoir recueilli de la
bouche de son maitre quelques notions de la science des astres,
complétées plus tard en Égypte, où sa vie errante l’avait amené,
revint ensuite dans son pays, y attira l’attention des chefs et du
peuple par les prédictions qu’il savait tirer des signes et
phénomènes célestes et finit par persuader au roi d’associer à son
pouvoir un homme qui, comme lui, pouvait être l’interprète des
volontés des Dieux. Il s’était vu alors nommer grand prêtre du
Dieu que les Gètes honorent le plus, mais ce n’était là qu’un
commencement, et l’on en était venu avec le temps à le considérer
lui-même comme Dieu.
La « divinité » Zalmoxis se contenta donc d’être un grand-prêtre.
Il faut dire qu’ayant trouvé en un lieu inaccessible une caverne
profonde il s’y était confiné, n’en sortant plus que rarement et ne
communiquant guère qu’avec le roi et ses ministres ; ajoutons
que le roi lui-même l’avait aidé à tromper les populations, voyant
qu’elles étaient devenues bien plus dociles à ses ordres depuis
qu’elles les croyaient dictés par l’inspiration même des Dieux.](https://image.slidesharecdn.com/dacia-250527082838-cfeb07bd/85/Dacia-Des-origines-inattendues-des-Daces-15-320.jpg)
![Dacia : Des origines inattendues des Daces
P a g e | 12
Seulement, la coutume s’en est perpétuée jusqu’à nous et depuis
Zamolxis il s’est toujours trouvé quelque imposteur comme lui
prêt à devenir le conseiller du prince régnant et à recevoir des
Gètes ce titre de Dieu.
Il inaugura ainsi une tradition politique dace qui consistait à impressionner la
population si l’autorité politique ne suffisait plus. On apprend surtout que la
caverne choisie par Zalmoxis se trouve dans un lieu inaccessible.
De même la montagne où Zamolxis s’était retiré et qui de son
temps passait pour sacrée est souvent encore aujourd’hui appelée
le Mont-Sacré, mais son vrai nom [et il appartient également à
la rivière qui passe au pied] est Cogaeonum.
Cogaeonum-Kogaionon n’attendit donc pas Zalmoxis pour devenir une montagne
sacrée. Cela dit, malgré son métier de géographe, Strabon ne précise pas sa
situation géographique. De toute façon, de son point de vue antique, le territoire
des Daces se trouvait en « Germanie » méridionale.
D’autres pistes géographiques existent dans les Carpates méridionales : le massif
calcaire blanc de Piatra Craiului, les monts Făgăraș, etc.
Pour avancer, nous avons varié nos combinaisons de mots clés sur des moteurs de
recherche et un des résultats nous intrigue.](https://image.slidesharecdn.com/dacia-250527082838-cfeb07bd/85/Dacia-Des-origines-inattendues-des-Daces-16-320.jpg)